Médicaments et randonnée, un risque à balancer
Par Doc du Sport le 3 octobre 2025
Impossible de nier ses maux même si l’on cherche à les oublier en prenant l’air. La randonnée a de nombreuses vertus mais seulement avec ses médicaments à portée de main et à condition qu’ils soient compatibles avec l’activité envisagée. Voici un éclairage comme une (petite) prise de chou…
Par le Dr Sophie Duméry, Membre De La Commission Médicale Fédérale
L’impact de l’effort envisagé
Vérifiez que votre état de forme est compatible avec la randonnée envisagée sous traitement bien suivi. Vos médicaments habituels et leur dosage sont à adapter à l’intensité de la randonnée (bloqueurs du rythme cardiaque, antiasthmatiques, etc.) et surtout à ses tribulations, hautement probables en itinérance. Que va-t-il se passer en cas de déshydratation, de course impromptue (troupeau de bovins peu amènes), de diarrhée profuse sur le chemin, de nuages polliniques ou d’épandages agricoles, de dégustation de tord-boyaux du terroir ? Bref, apprenez à moduler les doses vous-même sur instruction médicale détaillée. Celle-ci est imprimée et placée dans la boîte à médicaments (légère et résistante à l’écrasement, facilement accessible). Une fiche de gestes d’urgence pour un quidam qui aurait à intervenir est aussi nécessaire en cas de malaise qui vous laisserait confus ou inconscient.
Vigilance comme sur la route
Les maladies chroniques imposent fréquemment de prendre des médicaments tous les jours ou des médicaments à longue durée d’action. L’habitude ne doit pas en faire négliger les effets indésirables. Il n’est pas non plus évident de s’interroger sur un médicament pris transitoirement et justement pour randonner tranquillement… Le premier danger à anticiper est l’altération de la vigilance, source de chutes et de traumatismes plus ou moins sévères dont on se serait bien passé. Pour bien l’appréhender, il faut se reporter à la prévention routière : les consignes de vigilance au volant concernent tout autant le marcheur et son matériel (sac, bâtons, appareil photo, etc.) que l’automobiliste ; d’autant que rejoindre le départ d’une randonnée se fait le plus souvent en prenant sa voiture. Ne jetez pas la boîte de vos médicaments ! Les logos bien visibles sont là pour informer même les analphabètes d’une baisse de vigilance, ainsi que la notice, faite pour être consultée. Certes, elle inquiète plus qu’elle ne fournit précisément le risque de somnolence et/ou de confusion lors d’une prise unique ou répétée du médicament. En parler à son médecin est le conseil officiel raisonnable mais en période de désertification médicale, le praticien a rarement le temps de s’éterniser sur des effets secondaires… qu’il connaît parfois mal.
Se tourner vers des informations fiables
Le premier site recommandable est celui du ministère de la Santé : la base de données publique des médicaments, consultable ici : https://base-donnees-publique.medicaments. gouv.fr. Mais il faut connaître les noms du ou des médicaments. Combien de patients les connaissent ? Autre référence, l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) (https://ansm.sante.fr/page/liste-des-centresregionaux-de-pharmacovigilance) présente les 31 centres régionaux de pharmacovigilance répartis sur le territoire, « de façon à favoriser les échanges de proximité avec les professionnels de santé et les patients ». Prenez l’Agence au mot ! Adressez-vous à votre centre régional dans un message poli et précisant bien votre demande. Mettez les formes d’une missive officielle, cela disposera votre interlocuteur à vous répondre sans tarder.
Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site national des centres de pharmacovigilance (https://www.rfcrpv.fr) et vous abonner à la lettre d’information si vous avez une liste de médicaments longue comme le bras, ou simplement longue comme la main. Il est conseillé d’y recourir surtout pour éviter de se procurer tout et n’importe quoi sur Internet (voir encadré). Les alertes, comme les informations, sont dignes de confiance. Parce qu’il n’y a pas que la baisse de vigilance qui est à craindre lorsqu’on absorbe un médicament et qu’on randonne.
Les saignements intempestifs à la moindre blessure
Les motifs d’un traitement par anticoagulants ou d’antithrombotiques, tous deux prescrits pour fluidifier le sang, sont nombreux et très répandus dans la population. Bien avant le risque de phlébite, c’est le risque de caillot par fibrillation auriculaire (les oreillettes cardiaques qui battent n’importe comment) qui est le plus répandu avec les suites d’un infarctus cardiaque ou cérébral. Les prothèses vasculaires, qu’on implante dans les artères, justifient aussi la prise continue de ces médicaments fluidifiant le sang. On peut se renseigner sur le site de l’Assurance maladie (https://www.ameli.fr/assure/ sante/medicaments/comprendre-les-differents-medicaments/ anticoagulants). Ajoutons que l’aspirine fait partie des antiagrégants, moins puissants que les anticoagulants mais tout aussi capables de vous faire saigner plus longtemps à la moindre blessure cutanée : roncier, Opinel® sauvage, graminée coupe-papier, etc. Si l’on met généralement en garde les patients sous anticoagulants contre les divers chocs et plaies à cause du risque hémorragique, on est moins attentif concernant l’aspirine. Or, il est assez naturel de s’effrayer d’un saignement qui se prolonge ou d’un hématome grossissant à vue d’œil.
Pas question de modifier le traitement médical ! On ne touche à rien, mais on prévoit :
- de ne pas chuter ou se cogner, d’éviter les blessures grâce à une organisation et un itinéraire bien pensé ;
- de quoi comprimer longtemps une plaie ou une ecchymose. Enfin, l’avis des secours ou d’un professionnel de santé est requis quand le choc ou la blessure sont susceptibles de beaucoup saigner.
L’alimentation joue aussi
Ce que nous mangeons et buvons interagit avec les médicaments, en augmentant ou en réduisant leur absorption digestive et leur concentration sanguine. Parmi les aliments dont il faut se méfier se trouvent le pamplemousse et certains agrumes proches, contenant de la bergamottine. C’est une histoire d’interaction médicamenteuse (voir encadré). Le pamplemousse est un inhibiteur enzymatique, c’est-à-dire qu’il augmente les concentrations sanguines des médicaments, dans la journée qui suit. Alors ? Pensez à l’effet désastreux d’un surdosage aux anticoagulants et autres médicaments pour le cœur, mais aussi aux somnifères, anxiolytiques et antiépileptiques, ainsi qu’aux antipsychotiques. Ces derniers peuvent mettre l’organisme dans un état second incompatible avec la sécurité en randonnée. Pour ne rien dire des automédications par « condiments cannabinés » destinés à satelliser le cerveau façon GPS pas cher : « je la sens la balise GR, je la sens, elle est là ! »
Effets très indésirables et imprévus
En dehors des surdosages, les effets indésirables des médicaments sont toujours à redouter. Même avec une prescription prudente, il y a toujours au sein d’une population des réactions qui ne sont pas indiquées dans la notice. Elles sont imprévisibles parce que liées à la génétique individuelle par exemple. Il est sympa de les déclarer, pour éviter à d’autres d’en faire l’expérience, sur le site gouvernemental dédié (https://signalement.social-sante.gouv.fr).
Faut-il commencer un nouveau traitement lors d’une randonnée itinérante loin de tout ? Certainement pas ! Dans une randonnée, rien ne doit être nouveau en dehors de l’espace naturel, et encore… L’animateur ou le responsable auront reconnu le terrain autant que possible. Gare à l’automédication en situation imprévue : on doit connaître sa tolérance au produit qui ne doit pas être nouveau lui non plus. À défaut, demandez toujours l’avis du pharmacien. Et ne prenez jamais le comprimé d’un(e) ami(e) qui vous assure que « ça marche drôlement bien » pour ce que vous avez. À moins qu’il soit médecin ou pharmacien, il n’y a pas mieux pour avoir des ennuis : sanitaires pour le consommateur, judiciaires pour le prescripteur hors la loi.
Automédication « sportive » : même pas sous protection divine
Il n’est pas prudent quand on tient à la vie d’absorber des ingrédients inconnus, dont on ne connaît pas les effets immédiats et à distance. Les truands du commerce en ligne et des réseaux sociaux vous y invitent avec force discours « de bonne foi » qui tiennent du conte de fées. Et de la pression de la mode : pour être « cool », on ingurgite des mélanges de plantes, champignons, vitamines, poudres amaigrissantes et musculantes, à la légalité souvent douteuse. Avec ces formules pour développer la vigilance, la puissance, quasi des superpouvoirs chamaniques en milieu hostile, les risques toxiques sont légion. Et le décès pas du tout anecdotique avec un peu de déshydratation en sus en cours d’effort… Le milieu sportif est un boulevard pour les trafics juteux. N’y cédez pas, même sous protection de votre divinité préférée. Réorientez votre budget randonnée vers une nourriture saine et appropriée à votre dépense calorique, et vers un matériel solide bien adapté à vos besoins sportifs.
Interactions médicamenteuses, késaco ?
Les interactions médicamenteuses modifient le sort d’un médicament dans l’organisme (absorption, distribution, élimination) à cause d’un médicament associé (conventionnel ou complémentaire) ou à cause d’un aliment. Le résultat est soit une augmentation, soit une diminution des concentrations sanguines du médicament. Ces modifications sont d’importance variable mais peuvent conduire dans des situations extrêmes à une contre-indication absolue d’association. Il s’agit plus souvent d’une inhibition des enzymes cellulaires par le produit concerné. Elle entraîne un « blocage » du métabolisme du médicament qui « stagne » dans l’organisme : sa concentration augmente dans le sang provoquant un surdosage insidieux. À l’inverse, les produits dits « activateurs enzymatiques » accélèrent le métabolisme, avec la disparition rapide du médicament dans le sang, provoquant un sous-dosage lui aussi insidieux. Ce mécanisme accélérateur est lent : sept à dix jours pour un effet maximal. En revanche, l’inhibition enzymatique est très rapide : 24 à 38 heures. Soit un péril quasi immédiat : qu’on se le dise !
Vous aimerez aussi...
Magazine en ligne
Instagram
![👣 Sportives : à vos pieds !
On parle souvent de performance, rarement des pieds qui la portent.
Et pourtant, ils sont la base de tout mouvement, et encore plus pour les femmes.
Le corps féminin possède des spécificités biomécaniques uniques : bassin plus large, laxité ligamentaire, variations hormonales… autant de facteurs qui influencent la posture, la stabilité et la performance.
➡️ Découvrez comment la podologie du sport aide à prévenir les blessures, corriger les déséquilibres et optimiser chaque foulée.
Parce qu’une sportive bien ancrée, c’est une sportive plus forte 💪
📖 À lire sur Doc du Sport (lien dans la bio)]()
 👣 Sportives : à vos pieds ! On parle souvent de performance, rarement des pieds qui la portent. Et pourtant, ils sont la base de tout mouvement, et encore plus pour les femmes. Le corps féminin possède des spécificités biomécaniques uniques : bassin plus large, laxité ligamentaire, variations hormonales… autant de facteurs qui influencent la posture, la stabilité et la performance. ➡️ Découvrez comment la podologie du sport aide à prévenir les blessures, corriger les déséquilibres et optimiser chaque foulée. Parce qu’une sportive bien ancrée, c’est une sportive plus forte 💪 📖 À lire sur Doc du Sport (lien dans la bio)9 heures ago
👣 Sportives : à vos pieds ! On parle souvent de performance, rarement des pieds qui la portent. Et pourtant, ils sont la base de tout mouvement, et encore plus pour les femmes. Le corps féminin possède des spécificités biomécaniques uniques : bassin plus large, laxité ligamentaire, variations hormonales… autant de facteurs qui influencent la posture, la stabilité et la performance. ➡️ Découvrez comment la podologie du sport aide à prévenir les blessures, corriger les déséquilibres et optimiser chaque foulée. Parce qu’une sportive bien ancrée, c’est une sportive plus forte 💪 📖 À lire sur Doc du Sport (lien dans la bio)9 heures ago![💥 À 30 ans, il est déjà au sommet du trail mondial.
Troisième de l’UTMB® 2025, Josh Wade incarne une nouvelle génération de coureurs : exigeants, connectés à la nature et profondément humains 🌍
👉 Son secret ? La régularité, le sommeil et une écoute fine de son corps.
Entre rigueur et plaisir, il prouve qu’on peut performer sans se brûler.
📖 Découvrez son parcours et ses conseils inspirants pour progresser durablement sur www.docdusport.com (lien dans la bio).]()
 💥 À 30 ans, il est déjà au sommet du trail mondial. Troisième de l’UTMB® 2025, Josh Wade incarne une nouvelle génération de coureurs : exigeants, connectés à la nature et profondément humains 🌍 👉 Son secret ? La régularité, le sommeil et une écoute fine de son corps. Entre rigueur et plaisir, il prouve qu’on peut performer sans se brûler. 📖 Découvrez son parcours et ses conseils inspirants pour progresser durablement sur www.docdusport.com (lien dans la bio).4 jours ago
💥 À 30 ans, il est déjà au sommet du trail mondial. Troisième de l’UTMB® 2025, Josh Wade incarne une nouvelle génération de coureurs : exigeants, connectés à la nature et profondément humains 🌍 👉 Son secret ? La régularité, le sommeil et une écoute fine de son corps. Entre rigueur et plaisir, il prouve qu’on peut performer sans se brûler. 📖 Découvrez son parcours et ses conseils inspirants pour progresser durablement sur www.docdusport.com (lien dans la bio).4 jours ago![👩🦳 Sportives, la ménopause n’est pas la fin de votre vitalité !
Douleurs, fatigue, perte de motivation… autant de symptômes liés à la chute des œstrogènes. Mais saviez-vous qu’un traitement hormonal bien adapté pouvait réellement vous aider à préserver vos muscles, vos articulations et votre plaisir de bouger ?
🔬 L’étude américaine de 2002 avait semé la panique, mais depuis, la science a beaucoup évolué.
En France, les traitements sont aujourd’hui plus sûrs, naturels et personnalisés.
👉 Découvrez comment la médecine du sport repense la ménopause pour permettre aux femmes de rester actives, fortes et épanouies :
📖 Lire l’article complet sur Doc du Sport (lien das la bio).]()
 👩🦳 Sportives, la ménopause n’est pas la fin de votre vitalité ! Douleurs, fatigue, perte de motivation… autant de symptômes liés à la chute des œstrogènes. Mais saviez-vous qu’un traitement hormonal bien adapté pouvait réellement vous aider à préserver vos muscles, vos articulations et votre plaisir de bouger ? 🔬 L’étude américaine de 2002 avait semé la panique, mais depuis, la science a beaucoup évolué. En France, les traitements sont aujourd’hui plus sûrs, naturels et personnalisés. 👉 Découvrez comment la médecine du sport repense la ménopause pour permettre aux femmes de rester actives, fortes et épanouies : 📖 Lire l’article complet sur Doc du Sport (lien das la bio).1 semaine ago
👩🦳 Sportives, la ménopause n’est pas la fin de votre vitalité ! Douleurs, fatigue, perte de motivation… autant de symptômes liés à la chute des œstrogènes. Mais saviez-vous qu’un traitement hormonal bien adapté pouvait réellement vous aider à préserver vos muscles, vos articulations et votre plaisir de bouger ? 🔬 L’étude américaine de 2002 avait semé la panique, mais depuis, la science a beaucoup évolué. En France, les traitements sont aujourd’hui plus sûrs, naturels et personnalisés. 👉 Découvrez comment la médecine du sport repense la ménopause pour permettre aux femmes de rester actives, fortes et épanouies : 📖 Lire l’article complet sur Doc du Sport (lien das la bio).1 semaine ago![📢 NOUVEAU! FOOT SANTÉ 2025 : DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE ! 🏃♂️💥
🔥 Passionné.e.s de foot, ce numéro est fait pour vous ! 🔥
➡️ Un concentré d’expertise et de conseils.
💡 Au sommaire :
✅ Pour l’amour du foot… et de son papa !
✅ Les différentes pratiques foot santé
✅ Les avantages sur la santé de la pratique du foot santé
✅ Les blessures dans le football
✅ Programme de prévention des blessures dans le football amateur
✅ Les lumbagos des jeunes footballeurs sont des fractures… jusqu’à preuve du contraire !
✅ Le retour au football après une rupture du ligament croisé antérieur du genou
✅ Le claquage des ischiojambiers : la plaie du footballeur
✅ Les spécificités du football féminin
✅ Bouger pour la santé des hommes : quand le sport devient un véritable traitement
📅 Précommandez dès maintenant pour être sûr de recevoir votre exemplaire ! 🎯
🔗 A précommander jusqu'au 11 novembre sur www.docdusport.com (lien dans la bio)]()
 📢 NOUVEAU! FOOT SANTÉ 2025 : DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE ! 🏃♂️💥 🔥 Passionné.e.s de foot, ce numéro est fait pour vous ! 🔥 ➡️ Un concentré d’expertise et de conseils. 💡 Au sommaire : ✅ Pour l’amour du foot… et de son papa ! ✅ Les différentes pratiques foot santé ✅ Les avantages sur la santé de la pratique du foot santé ✅ Les blessures dans le football ✅ Programme de prévention des blessures dans le football amateur ✅ Les lumbagos des jeunes footballeurs sont des fractures… jusqu’à preuve du contraire ! ✅ Le retour au football après une rupture du ligament croisé antérieur du genou ✅ Le claquage des ischiojambiers : la plaie du footballeur ✅ Les spécificités du football féminin ✅ Bouger pour la santé des hommes : quand le sport devient un véritable traitement 📅 Précommandez dès maintenant pour être sûr de recevoir votre exemplaire ! 🎯 🔗 A précommander jusqu'au 11 novembre sur www.docdusport.com (lien dans la bio)2 semaines ago
📢 NOUVEAU! FOOT SANTÉ 2025 : DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE ! 🏃♂️💥 🔥 Passionné.e.s de foot, ce numéro est fait pour vous ! 🔥 ➡️ Un concentré d’expertise et de conseils. 💡 Au sommaire : ✅ Pour l’amour du foot… et de son papa ! ✅ Les différentes pratiques foot santé ✅ Les avantages sur la santé de la pratique du foot santé ✅ Les blessures dans le football ✅ Programme de prévention des blessures dans le football amateur ✅ Les lumbagos des jeunes footballeurs sont des fractures… jusqu’à preuve du contraire ! ✅ Le retour au football après une rupture du ligament croisé antérieur du genou ✅ Le claquage des ischiojambiers : la plaie du footballeur ✅ Les spécificités du football féminin ✅ Bouger pour la santé des hommes : quand le sport devient un véritable traitement 📅 Précommandez dès maintenant pour être sûr de recevoir votre exemplaire ! 🎯 🔗 A précommander jusqu'au 11 novembre sur www.docdusport.com (lien dans la bio)2 semaines ago![💫 Et si la ménopause devenait une nouvelle force ?
Pas besoin de courir un marathon : juste bouger un peu, souvent, et avec plaisir 🧘♀️
💨 Moins de bouffées de chaleur
😴 Un meilleur sommeil
💃 Une humeur plus stable
🦴 Des os plus solides
💖 Et une peau plus éclatante !
Le sport, c’est bien plus qu’un antidote naturel : c’est une clé pour mieux vivre cette nouvelle phase de vie 🌸
📖 Découvrez comment bouger selon les 4 piliers de la HAS dans notre nouvel article (lien en bio).]()
 💫 Et si la ménopause devenait une nouvelle force ? Pas besoin de courir un marathon : juste bouger un peu, souvent, et avec plaisir 🧘♀️ 💨 Moins de bouffées de chaleur 😴 Un meilleur sommeil 💃 Une humeur plus stable 🦴 Des os plus solides 💖 Et une peau plus éclatante ! Le sport, c’est bien plus qu’un antidote naturel : c’est une clé pour mieux vivre cette nouvelle phase de vie 🌸 📖 Découvrez comment bouger selon les 4 piliers de la HAS dans notre nouvel article (lien en bio).2 semaines ago
💫 Et si la ménopause devenait une nouvelle force ? Pas besoin de courir un marathon : juste bouger un peu, souvent, et avec plaisir 🧘♀️ 💨 Moins de bouffées de chaleur 😴 Un meilleur sommeil 💃 Une humeur plus stable 🦴 Des os plus solides 💖 Et une peau plus éclatante ! Le sport, c’est bien plus qu’un antidote naturel : c’est une clé pour mieux vivre cette nouvelle phase de vie 🌸 📖 Découvrez comment bouger selon les 4 piliers de la HAS dans notre nouvel article (lien en bio).2 semaines ago![💨 Vous courez, mais respirez-vous vraiment ?
Le souffle, c’est votre moteur caché en trail. Et pourtant, peu de coureurs le travaillent.
🧘♂️ Respiration abdominale
🔲 Respiration au carré
❤️ Cohérence cardiaque
Ces 3 techniques simples peuvent vous aider à :
✨ Mieux gérer le stress
💪 Repousser la fatigue
🧠 Garder la lucidité quand tout devient flou
Respirer, c’est courir plus loin, plus fort, plus serein 🌿
Découvrez comment dans notre dernier article (lien en bio).]()
 💨 Vous courez, mais respirez-vous vraiment ? Le souffle, c’est votre moteur caché en trail. Et pourtant, peu de coureurs le travaillent. 🧘♂️ Respiration abdominale 🔲 Respiration au carré ❤️ Cohérence cardiaque Ces 3 techniques simples peuvent vous aider à : ✨ Mieux gérer le stress 💪 Repousser la fatigue 🧠 Garder la lucidité quand tout devient flou Respirer, c’est courir plus loin, plus fort, plus serein 🌿 Découvrez comment dans notre dernier article (lien en bio).3 semaines ago
💨 Vous courez, mais respirez-vous vraiment ? Le souffle, c’est votre moteur caché en trail. Et pourtant, peu de coureurs le travaillent. 🧘♂️ Respiration abdominale 🔲 Respiration au carré ❤️ Cohérence cardiaque Ces 3 techniques simples peuvent vous aider à : ✨ Mieux gérer le stress 💪 Repousser la fatigue 🧠 Garder la lucidité quand tout devient flou Respirer, c’est courir plus loin, plus fort, plus serein 🌿 Découvrez comment dans notre dernier article (lien en bio).3 semaines ago![🚨 90 à 120 g de sucre par heure pendant l’effort ?
C’est la nouvelle mode du moment… mais c’est aussi l’équivalent d’1 LITRE de soda ! 😱
Et si on revenait au bon sens sportif ?
🧠 Le @docteurstephanecascua, médecin du sport, explique pourquoi ces excès risquent de nuire à votre santé ET à votre performance.
🔗 Toutes les infos à retrouver dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com.]()
 🚨 90 à 120 g de sucre par heure pendant l’effort ? C’est la nouvelle mode du moment… mais c’est aussi l’équivalent d’1 LITRE de soda ! 😱 Et si on revenait au bon sens sportif ? 🧠 Le @docteurstephanecascua, médecin du sport, explique pourquoi ces excès risquent de nuire à votre santé ET à votre performance. 🔗 Toutes les infos à retrouver dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com.3 semaines ago
🚨 90 à 120 g de sucre par heure pendant l’effort ? C’est la nouvelle mode du moment… mais c’est aussi l’équivalent d’1 LITRE de soda ! 😱 Et si on revenait au bon sens sportif ? 🧠 Le @docteurstephanecascua, médecin du sport, explique pourquoi ces excès risquent de nuire à votre santé ET à votre performance. 🔗 Toutes les infos à retrouver dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com.3 semaines ago![💗 Et si votre cycle était votre superpouvoir ?
Chaque phase a son énergie, ses défis, ses atouts.
Comprendre son cycle, c’est comprendre son corps, et l’utiliser comme un vrai levier de performance.
🌸 Inspiré du livre Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme d’ @equilibresse_symptothermie.
👉 Découvrez comment votre cycle peut booster votre entraînement dans notre dernier article !
🔗 Lien en bio]()
 💗 Et si votre cycle était votre superpouvoir ? Chaque phase a son énergie, ses défis, ses atouts. Comprendre son cycle, c’est comprendre son corps, et l’utiliser comme un vrai levier de performance. 🌸 Inspiré du livre Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme d’ @equilibresse_symptothermie. 👉 Découvrez comment votre cycle peut booster votre entraînement dans notre dernier article ! 🔗 Lien en bio4 semaines ago
💗 Et si votre cycle était votre superpouvoir ? Chaque phase a son énergie, ses défis, ses atouts. Comprendre son cycle, c’est comprendre son corps, et l’utiliser comme un vrai levier de performance. 🌸 Inspiré du livre Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme d’ @equilibresse_symptothermie. 👉 Découvrez comment votre cycle peut booster votre entraînement dans notre dernier article ! 🔗 Lien en bio4 semaines ago![👣 Vos pieds sont vos premiers « partenaires d’entraînement » 🏔️
Mais les travaillez-vous vraiment ?
Quelques minutes d’exercices simples peuvent changer votre foulée — et votre plaisir de courir.
💪 Préparez vos pieds, et ils vous le rendront sur chaque sentier !
🔗 Lien en bio
👉 Enregistrez ce post pour vos prochains entraînements !]()
 👣 Vos pieds sont vos premiers « partenaires d’entraînement » 🏔️ Mais les travaillez-vous vraiment ? Quelques minutes d’exercices simples peuvent changer votre foulée — et votre plaisir de courir. 💪 Préparez vos pieds, et ils vous le rendront sur chaque sentier ! 🔗 Lien en bio 👉 Enregistrez ce post pour vos prochains entraînements !4 semaines ago
👣 Vos pieds sont vos premiers « partenaires d’entraînement » 🏔️ Mais les travaillez-vous vraiment ? Quelques minutes d’exercices simples peuvent changer votre foulée — et votre plaisir de courir. 💪 Préparez vos pieds, et ils vous le rendront sur chaque sentier ! 🔗 Lien en bio 👉 Enregistrez ce post pour vos prochains entraînements !4 semaines agoFacebook
-
Articles récents
- Sportives : à vos pieds !
- Josh Wade, au sommet de son art
- Un traitement hormonal de la ménopause pour la sportive ?
- Fartlek® Carrefour, la renaissance d’une séance efficace
- Pourquoi et comment faire du sport pour mieux vivre la ménopause ?
- Maîtrise ton souffle pour dompter le trail : les techniques de respiration au service de la performance
- 90 à 120 grammes de glucides par heure; on se calme !
- Et si votre cycle menstruel était votre allié ?
- La préparation du pied en trail: un indispensable pour courir longtemps et sans détériorer sa foulée
- Le trail au féminin, essor et spécificités
- Médicaments et randonnée, un risque à balancer
- Kilomètre Vertical, le trail santé !
- Tendinite d’Achille et randonnée : des spécificités!
- Pédale douce sur les « régimes »
- Esther Abrami : le violon comme un sport
-
-
 Doc du Sport | 19 juin 2020
Doc du Sport | 19 juin 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 18 décembre 2018
Dr Stéphane Cascua | 18 décembre 2018
Tendinite et protocole de Stanish: des douleurs pour soigner vos tendons !
-
 Dr Marc Rozenblat | 9 janvier 2019
Dr Marc Rozenblat | 9 janvier 2019
Utilisation du plasma riche en plaquettes (PRP) en Traumatologie du Sport
-
 Dr Stéphane Cascua | 5 novembre 2019
Dr Stéphane Cascua | 5 novembre 2019
Entraînement – la séance au seuil: tout ce que vous devez connaître
-
 Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019
Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019
-
 Anne Odru | 14 janvier 2019
Anne Odru | 14 janvier 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019
Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019
Du gras pour maigrir et pour courir: le processus épigénétique
-
 Dr Stéphane Cascua | 11 octobre 2019
Dr Stéphane Cascua | 11 octobre 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2019
Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2019
La brasse: une nage excellente pour votre condition physique
-
 Doc du Sport | 6 décembre 2019
Doc du Sport | 6 décembre 2019
-
 Charles-Antoine Winter | 22 février 2019
Charles-Antoine Winter | 22 février 2019
Comment prévenir et soigner une tendinite par la diététique?
-
 Dr Stéphane Cascua | 26 avril 2019
Dr Stéphane Cascua | 26 avril 2019
-
 Anne Odru | 15 mai 2019
Anne Odru | 15 mai 2019
-
 Doc du Sport | 26 novembre 2019
Doc du Sport | 26 novembre 2019
Marche nordique: comment débuter et progresser efficacement ?
-
 Doc du Sport | 27 mai 2020
Doc du Sport | 27 mai 2020
-
 Doc du Sport | 22 juillet 2020
Doc du Sport | 22 juillet 2020
GOLF: l’intérêt de la paire d’orthèses plantaires sur-mesure, hors troubles statiques classiques
-
 Doc du Sport | 4 août 2020
Doc du Sport | 4 août 2020
-
 Doc du Sport | 3 avril 2019
Doc du Sport | 3 avril 2019
-
 Doc du Sport | 26 juillet 2019
Doc du Sport | 26 juillet 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 15 août 2019
Dr Stéphane Cascua | 15 août 2019
-
 Doc du Sport | 18 septembre 2019
Doc du Sport | 18 septembre 2019
-
 Doc du Sport | 27 septembre 2019
Doc du Sport | 27 septembre 2019
Préparation Trail: bien gérer sa Préparation Physique Générale (PPG)
-
 Doc du Sport | 17 décembre 2019
Doc du Sport | 17 décembre 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 10 janvier 2020
Dr Stéphane Cascua | 10 janvier 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 21 février 2020
Dr Stéphane Cascua | 21 février 2020
-
 Doc du Sport | 13 mars 2020
Doc du Sport | 13 mars 2020
Boisson d’effort et boisson de récupération: faut-il bannir les boissons d’effort?
-
 Dr Stéphane Cascua | 24 mars 2020
Dr Stéphane Cascua | 24 mars 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019
Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019
Minimaliste à minima: une méthode idéale pour les triathlètes
-
 Dr Stéphane Cascua | 21 janvier 2019
Dr Stéphane Cascua | 21 janvier 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019
Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 12 février 2019
Dr Stéphane Cascua | 12 février 2019
-
 Doc du Sport | 18 mars 2019
Doc du Sport | 18 mars 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 18 avril 2019
Dr Stéphane Cascua | 18 avril 2019
-
 Doc du Sport | 13 juin 2019
Doc du Sport | 13 juin 2019
-
 Doc du Sport | 6 août 2019
Doc du Sport | 6 août 2019
Maladie de Lyme et tiques: tout ce qu’il faut savoir pour une bonne prévention
-
 Doc du Sport | 22 août 2019
Doc du Sport | 22 août 2019
-
 Doc du Sport | 25 septembre 2019
Doc du Sport | 25 septembre 2019
-
 Doc du Sport | 20 octobre 2019
Doc du Sport | 20 octobre 2019
-
 Doc du Sport | 25 octobre 2019
Doc du Sport | 25 octobre 2019
Randonnée: la marche nordique pour une meilleure préparation
-
 Doc du Sport | 7 novembre 2019
Doc du Sport | 7 novembre 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 3 décembre 2019
Dr Stéphane Cascua | 3 décembre 2019
Douleurs d’épaule du nageur: explication, prévention et préparation
-
 Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2019
Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2019
-
 Anne Odru | 20 décembre 2019
Anne Odru | 20 décembre 2019
Christophe Ruelle: « La volonté est la clé de la réussite! »
-
 Doc du Sport | 23 décembre 2019
Doc du Sport | 23 décembre 2019
-
 Doc du Sport | 7 janvier 2020
Doc du Sport | 7 janvier 2020
-
 Charles-Antoine Winter | 4 février 2020
Charles-Antoine Winter | 4 février 2020
La diététique pour prévenir et lutter contre les aménorrhées?
-
 Doc du Sport | 7 février 2020
Doc du Sport | 7 février 2020
2 séances de qualité pour améliorer ses performances en cyclisme
-
 Dr Stéphane Cascua | 22 avril 2020
Dr Stéphane Cascua | 22 avril 2020
-
 Doc du Sport | 30 juin 2020
Doc du Sport | 30 juin 2020
-
 Doc du Sport | 6 juillet 2020
Doc du Sport | 6 juillet 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 8 juillet 2020
Dr Stéphane Cascua | 8 juillet 2020
-
 Doc du Sport | 17 juillet 2020
Doc du Sport | 17 juillet 2020
-
 Doc du Sport | 27 juillet 2020
Doc du Sport | 27 juillet 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 29 juillet 2020
Dr Stéphane Cascua | 29 juillet 2020
-
 Doc du Sport | 6 août 2020
Doc du Sport | 6 août 2020
-
 Doc du Sport | 25 août 2020
Doc du Sport | 25 août 2020
Roxana Maracineanu: une ministre engagée dans le Sport Santé
-
 Doc du Sport | 31 août 2020
Doc du Sport | 31 août 2020
Bénéfices du vélo dans le cadre des pathologies ostéoarticulaires chroniques
-
 Doc du Sport | 4 septembre 2020
Doc du Sport | 4 septembre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 20 octobre 2020
Dr Stéphane Cascua | 20 octobre 2020
-
 Doc du Sport | 22 octobre 2020
Doc du Sport | 22 octobre 2020
-
 Doc du Sport | 10 novembre 2020
Doc du Sport | 10 novembre 2020
Maux de dos, tensions, stress: les gym douces à la rescousse
-
 Gregory | 12 novembre 2020
Gregory | 12 novembre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 15 décembre 2020
Dr Stéphane Cascua | 15 décembre 2020
Plasma Riche en Plaquettes: une colle biologique pour vos blessures
-
 Dr Stéphane Cascua | 26 janvier 2021
Dr Stéphane Cascua | 26 janvier 2021
-
 Baptiste Nobilet | 5 janvier 2019
Baptiste Nobilet | 5 janvier 2019
-
 Doc du Sport | 9 janvier 2019
Doc du Sport | 9 janvier 2019
Nos conseils pour pratiquer le triathlon en cas de pathologie chronique associée
-
 Charles-Antoine Winter | 16 janvier 2019
Charles-Antoine Winter | 16 janvier 2019
-
 Doc du Sport | 28 janvier 2019
Doc du Sport | 28 janvier 2019
-
 Anne Odru | 6 février 2019
Anne Odru | 6 février 2019
- Baptiste Nobilet | 8 février 2019
-
 Anne Odru | 15 février 2019
Anne Odru | 15 février 2019
-
 Doc du Sport | 18 février 2019
Doc du Sport | 18 février 2019
-
 Doc du Sport | 20 février 2019
Doc du Sport | 20 février 2019
-
 Baptiste Nobilet | 27 février 2019
Baptiste Nobilet | 27 février 2019
-
 Dr Bruno Emram | 1 mars 2019
Dr Bruno Emram | 1 mars 2019
-
 Baptiste Nobilet | 15 mars 2019
Baptiste Nobilet | 15 mars 2019
-
 Doc du Sport | 15 mars 2019
Doc du Sport | 15 mars 2019
-
 Doc du Sport | 15 mars 2019
Doc du Sport | 15 mars 2019
-
 Doc du Sport | 20 mars 2019
Doc du Sport | 20 mars 2019
-
 Doc du Sport | 22 mars 2019
Doc du Sport | 22 mars 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 25 mars 2019
Dr Stéphane Cascua | 25 mars 2019
-
 Anne Odru | 27 mars 2019
Anne Odru | 27 mars 2019
-
 Doc du Sport | 29 mars 2019
Doc du Sport | 29 mars 2019
-
 Doc du Sport | 1 avril 2019
Doc du Sport | 1 avril 2019
-
 Doc du Sport | 5 avril 2019
Doc du Sport | 5 avril 2019
-
 Baptiste Nobilet | 12 avril 2019
Baptiste Nobilet | 12 avril 2019
-
 Anne Odru | 25 avril 2019
Anne Odru | 25 avril 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 29 avril 2019
Dr Stéphane Cascua | 29 avril 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 2 mai 2019
Dr Stéphane Cascua | 2 mai 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 7 mai 2019
Dr Stéphane Cascua | 7 mai 2019
-
 Anne Odru | 11 mai 2019
Anne Odru | 11 mai 2019
-
 Dr Marc Rozenblat | 14 mai 2019
Dr Marc Rozenblat | 14 mai 2019
-
 Anne Odru | 16 mai 2019
Anne Odru | 16 mai 2019
-
 Doc du Sport | 21 mai 2019
Doc du Sport | 21 mai 2019
Animateur de Loisirs Sportifs : le Certificat de Qualification Professionnelle
-
 Doc du Sport | 27 mai 2019
Doc du Sport | 27 mai 2019
-
 Charles-Antoine Winter | 11 juin 2019
Charles-Antoine Winter | 11 juin 2019
-
 Doc du Sport | 18 juin 2019
Doc du Sport | 18 juin 2019
-
 Doc du Sport | 26 juin 2019
Doc du Sport | 26 juin 2019
-
 Doc du Sport | 3 juillet 2019
Doc du Sport | 3 juillet 2019
-
 Doc du Sport | 8 juillet 2019
Doc du Sport | 8 juillet 2019
Le Canada man/woman: un triathlon extrême aux couleurs Mégantic
-
 Doc du Sport | 8 juillet 2019
Doc du Sport | 8 juillet 2019
-
 Doc du Sport | 10 juillet 2019
Doc du Sport | 10 juillet 2019
-
 Doc du Sport | 12 juillet 2019
Doc du Sport | 12 juillet 2019
Comment reprendre le golf après une prothèse totale du genou?
-
 Anne Odru | 15 juillet 2019
Anne Odru | 15 juillet 2019
Gwladys Nocera: « Pour gagner, il faut se connaître parfaitement! »
-
 Doc du Sport | 19 juillet 2019
Doc du Sport | 19 juillet 2019
Faire du golf avec un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur
-
 Anne Odru | 22 juillet 2019
Anne Odru | 22 juillet 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 31 juillet 2019
Dr Stéphane Cascua | 31 juillet 2019
-
 Doc du Sport | 8 août 2019
Doc du Sport | 8 août 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 13 août 2019
Dr Stéphane Cascua | 13 août 2019
-
 Doc du Sport | 20 août 2019
Doc du Sport | 20 août 2019
-
 Doc du Sport | 27 août 2019
Doc du Sport | 27 août 2019
-
 Anne Odru | 29 août 2019
Anne Odru | 29 août 2019
-
 Juliette Raudrant | 30 août 2019
Juliette Raudrant | 30 août 2019
Xavier Thévenard: « Avant de penser à performer, il faut être en bonne santé ».
-
 Anne Odru | 31 août 2019
Anne Odru | 31 août 2019
-
 Anne Odru | 4 septembre 2019
Anne Odru | 4 septembre 2019
-
 Anne Odru | 4 septembre 2019
Anne Odru | 4 septembre 2019
-
 Juliette Raudrant | 7 septembre 2019
Juliette Raudrant | 7 septembre 2019
-
 Doc du Sport | 13 septembre 2019
Doc du Sport | 13 septembre 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 1 octobre 2019
Dr Stéphane Cascua | 1 octobre 2019
-
 Anne Odru | 7 octobre 2019
Anne Odru | 7 octobre 2019
-
 Doc du Sport | 14 octobre 2019
Doc du Sport | 14 octobre 2019
-
 Doc du Sport | 18 octobre 2019
Doc du Sport | 18 octobre 2019
-
 Doc du Sport | 23 octobre 2019
Doc du Sport | 23 octobre 2019
Les risques infectieux lors de la pratique de la natation en eau libre
-
 Doc du Sport | 28 octobre 2019
Doc du Sport | 28 octobre 2019
-
 Doc du Sport | 29 octobre 2019
Doc du Sport | 29 octobre 2019
-
 Gregory | 12 novembre 2019
Gregory | 12 novembre 2019
-
 Doc du Sport | 18 novembre 2019
Doc du Sport | 18 novembre 2019
-
 Doc du Sport | 18 novembre 2019
Doc du Sport | 18 novembre 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 22 novembre 2019
Dr Stéphane Cascua | 22 novembre 2019
-
 Charles-Antoine Winter | 24 novembre 2019
Charles-Antoine Winter | 24 novembre 2019
-
 Doc du Sport | 28 novembre 2019
Doc du Sport | 28 novembre 2019
Incontinence urinaire de la femme sportive et des athlètes féminines
-
 Baptiste Nobilet | 8 décembre 2019
Baptiste Nobilet | 8 décembre 2019
-
 Anne Odru | 13 décembre 2019
Anne Odru | 13 décembre 2019
-
 Baptiste Nobilet | 21 décembre 2019
Baptiste Nobilet | 21 décembre 2019
-
 Doc du Sport | 30 décembre 2019
Doc du Sport | 30 décembre 2019
-
 Baptiste Nobilet | 11 janvier 2020
Baptiste Nobilet | 11 janvier 2020
-
 Doc du Sport | 14 janvier 2020
Doc du Sport | 14 janvier 2020
-
 Doc du Sport | 17 janvier 2020
Doc du Sport | 17 janvier 2020
La préparation physique aux séjours de ski et des sports d’hiver
-
 Anne Odru | 20 janvier 2020
Anne Odru | 20 janvier 2020
-
 Doc du Sport | 21 janvier 2020
Doc du Sport | 21 janvier 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 24 janvier 2020
Dr Stéphane Cascua | 24 janvier 2020
-
 Doc du Sport | 28 janvier 2020
Doc du Sport | 28 janvier 2020
-
 Charles-Antoine Winter | 31 janvier 2020
Charles-Antoine Winter | 31 janvier 2020
Allergie aux protéines de lait de vache (APLV): comment assurer ses apports protidiques journaliers?
-
 Baptiste Nobilet | 1 février 2020
Baptiste Nobilet | 1 février 2020
-
 Doc du Sport | 4 février 2020
Doc du Sport | 4 février 2020
-
 Baptiste Nobilet | 8 février 2020
Baptiste Nobilet | 8 février 2020
-
 Doc du Sport | 14 février 2020
Doc du Sport | 14 février 2020
-
 Doc du Sport | 19 février 2020
Doc du Sport | 19 février 2020
Les 4 piliers d’un bon entraînement pour préserver son capital santé
-
 Doc du Sport | 21 février 2020
Doc du Sport | 21 février 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 25 février 2020
Dr Stéphane Cascua | 25 février 2020
-
 Doc du Sport | 6 mars 2020
Doc du Sport | 6 mars 2020
-
 Charles-Antoine Winter | 10 mars 2020
Charles-Antoine Winter | 10 mars 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 12 mars 2020
Dr Stéphane Cascua | 12 mars 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 20 mars 2020
Dr Stéphane Cascua | 20 mars 2020
-
 Anne Odru | 8 avril 2020
Anne Odru | 8 avril 2020
-
 Anne Odru | 10 avril 2020
Anne Odru | 10 avril 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 15 avril 2020
Dr Stéphane Cascua | 15 avril 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 13 mai 2020
Dr Stéphane Cascua | 13 mai 2020
-
 Doc du Sport | 3 juillet 2020
Doc du Sport | 3 juillet 2020
-
 Doc du Sport | 10 juillet 2020
Doc du Sport | 10 juillet 2020
-
 Anne Odru | 13 juillet 2020
Anne Odru | 13 juillet 2020
-
 Doc du Sport | 15 juillet 2020
Doc du Sport | 15 juillet 2020
Le coude du golfeur: prévention et traitement des principales pathologies
-
 Anne Odru | 20 juillet 2020
Anne Odru | 20 juillet 2020
Marie Dorin-Habert: « Je n’arrêterai jamais d’aller marcher en montagne ! »
-
 Doc du Sport | 24 juillet 2020
Doc du Sport | 24 juillet 2020
-
 Charles-Antoine Winter | 31 juillet 2020
Charles-Antoine Winter | 31 juillet 2020
-
 Baptiste Nobilet | 1 août 2020
Baptiste Nobilet | 1 août 2020
-
 Anne Odru | 11 août 2020
Anne Odru | 11 août 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 13 août 2020
Dr Stéphane Cascua | 13 août 2020
-
 Baptiste Nobilet | 15 août 2020
Baptiste Nobilet | 15 août 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 18 août 2020
Dr Stéphane Cascua | 18 août 2020
-
 Doc du Sport | 20 août 2020
Doc du Sport | 20 août 2020
Commotion cérébrale: recommandations dans la pratique du cyclisme
-
 Baptiste Nobilet | 22 août 2020
Baptiste Nobilet | 22 août 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 27 août 2020
Dr Stéphane Cascua | 27 août 2020
-
 Baptiste Nobilet | 29 août 2020
Baptiste Nobilet | 29 août 2020
-
 Doc du Sport | 2 septembre 2020
Doc du Sport | 2 septembre 2020
-
 Doc du Sport | 7 septembre 2020
Doc du Sport | 7 septembre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 9 septembre 2020
Dr Stéphane Cascua | 9 septembre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 11 septembre 2020
Dr Stéphane Cascua | 11 septembre 2020
-
 Doc du Sport | 14 septembre 2020
Doc du Sport | 14 septembre 2020
Literie pour sportifs: tout ce que vous devez savoir pour votre récupération
-
 Doc du Sport | 16 septembre 2020
Doc du Sport | 16 septembre 2020
Troubles du comportement alimentaire: vers de nouvelles approches
-
 Doc du Sport | 18 septembre 2020
Doc du Sport | 18 septembre 2020
-
 Doc du Sport | 21 septembre 2020
Doc du Sport | 21 septembre 2020
-
 Doc du Sport | 23 septembre 2020
Doc du Sport | 23 septembre 2020
-
 Anne Odru | 25 septembre 2020
Anne Odru | 25 septembre 2020
-
 Anne Odru | 28 septembre 2020
Anne Odru | 28 septembre 2020
Élodie Clouvel: « J’apprends beaucoup sur moi grâce au sport. »
-
 Dr Stéphane Cascua | 2 octobre 2020
Dr Stéphane Cascua | 2 octobre 2020
Le parcours de musculation: le renforcement pour votre endurance
-
 Dr Stéphane Cascua | 5 octobre 2020
Dr Stéphane Cascua | 5 octobre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 7 octobre 2020
Dr Stéphane Cascua | 7 octobre 2020
-
 Doc du Sport | 9 octobre 2020
Doc du Sport | 9 octobre 2020
-
 Doc du Sport | 12 octobre 2020
Doc du Sport | 12 octobre 2020
-
 Doc du Sport | 14 octobre 2020
Doc du Sport | 14 octobre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 16 octobre 2020
Dr Stéphane Cascua | 16 octobre 2020
-
 Anne Odru | 27 octobre 2020
Anne Odru | 27 octobre 2020
-
 Anne Odru | 29 octobre 2020
Anne Odru | 29 octobre 2020
-
 Doc du Sport | 3 novembre 2020
Doc du Sport | 3 novembre 2020
-
 Doc du Sport | 5 novembre 2020
Doc du Sport | 5 novembre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 6 novembre 2020
Dr Stéphane Cascua | 6 novembre 2020
-
 Doc du Sport | 6 novembre 2020
Doc du Sport | 6 novembre 2020
-
 Anne Odru | 17 novembre 2020
Anne Odru | 17 novembre 2020
Muriel Hurtis: « le sport est très important face à certaines pathologies ».
-
 Doc du Sport | 19 novembre 2020
Doc du Sport | 19 novembre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 24 novembre 2020
Dr Stéphane Cascua | 24 novembre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 26 novembre 2020
Dr Stéphane Cascua | 26 novembre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 1 décembre 2020
Dr Stéphane Cascua | 1 décembre 2020
-
 Doc du Sport | 3 décembre 2020
Doc du Sport | 3 décembre 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 8 décembre 2020
Dr Stéphane Cascua | 8 décembre 2020
-
 Doc du Sport | 10 décembre 2020
Doc du Sport | 10 décembre 2020
-
 Anne Odru | 17 décembre 2020
Anne Odru | 17 décembre 2020
Laurence KLEIN: le trail, un bon équilibre entre le corps et la nature
-
 Doc du Sport | 5 janvier 2021
Doc du Sport | 5 janvier 2021
-
 Doc du Sport | 7 janvier 2021
Doc du Sport | 7 janvier 2021
-
 Doc du Sport | 14 janvier 2021
Doc du Sport | 14 janvier 2021
-
 Doc du Sport | 19 janvier 2021
Doc du Sport | 19 janvier 2021
-
 Doc du Sport | 21 janvier 2021
Doc du Sport | 21 janvier 2021
-
 Baptiste Nobilet | 30 janvier 2021
Baptiste Nobilet | 30 janvier 2021
-
 Doc du Sport | 3 février 2021
Doc du Sport | 3 février 2021
-
 Anne Odru | 5 février 2021
Anne Odru | 5 février 2021
Laëtitia Le Corguillé: « J’aime partager l’aspect santé de mon sport! »
-
 Anne Odru | 9 février 2021
Anne Odru | 9 février 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 11 février 2021
Dr Stéphane Cascua | 11 février 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 16 février 2021
Dr Stéphane Cascua | 16 février 2021
-
 Doc du Sport | 18 février 2021
Doc du Sport | 18 février 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 23 février 2021
Dr Stéphane Cascua | 23 février 2021
Fourmis dans les mains à vélo: est-ce un syndrome du canal carpien?
-
 Doc du Sport | 25 février 2021
Doc du Sport | 25 février 2021
-
 Doc du Sport | 2 mars 2021
Doc du Sport | 2 mars 2021
-
 Doc du Sport | 4 mars 2021
Doc du Sport | 4 mars 2021
-
 Anne Odru | 9 mars 2021
Anne Odru | 9 mars 2021
-
 Baptiste Nobilet | 13 mars 2021
Baptiste Nobilet | 13 mars 2021
-
 Doc du Sport | 16 mars 2021
Doc du Sport | 16 mars 2021
-
 Doc du Sport | 18 mars 2021
Doc du Sport | 18 mars 2021
Sport de haut niveau chez les enfants, comment être bien encadré
-
 Doc du Sport | 23 mars 2021
Doc du Sport | 23 mars 2021
Le Vélo à Assistance électrique (VAE): mon compagnon sport santé!
-
 Doc du Sport | 25 mars 2021
Doc du Sport | 25 mars 2021
Sport et innovations technologiques : une nouvelle alliance pour lutter contre la sédentarité
-
 Doc du Sport | 30 mars 2021
Doc du Sport | 30 mars 2021
-
 Anne Odru | 1 avril 2021
Anne Odru | 1 avril 2021
-
 Doc du Sport | 6 avril 2021
Doc du Sport | 6 avril 2021
- Doc du Sport | 7 avril 2021
-
 Doc du Sport | 8 avril 2021
Doc du Sport | 8 avril 2021
-
 Doc du Sport | 13 avril 2021
Doc du Sport | 13 avril 2021
-
 Anne Odru | 15 avril 2021
Anne Odru | 15 avril 2021
Marie-Amélie Le Fur: « le seul échec est de ne pas essayer. »
-
 Doc du Sport | 20 avril 2021
Doc du Sport | 20 avril 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 22 avril 2021
Dr Stéphane Cascua | 22 avril 2021
-
 Doc du Sport | 27 avril 2021
Doc du Sport | 27 avril 2021
-
 Doc du Sport | 29 avril 2021
Doc du Sport | 29 avril 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 4 mai 2021
Dr Stéphane Cascua | 4 mai 2021
-
 Anne Odru | 6 mai 2021
Anne Odru | 6 mai 2021
Martin Fourcade: « Tout ce que je sais faire, c’est grâce au sport. »
-
 Doc du Sport | 11 mai 2021
Doc du Sport | 11 mai 2021
Comment prévenir des noyades et développer l’aisance aquatique
-
 Gregory | 13 mai 2021
Gregory | 13 mai 2021
-
 Doc du Sport | 18 mai 2021
Doc du Sport | 18 mai 2021
-
 Doc du Sport | 20 mai 2021
Doc du Sport | 20 mai 2021
-
 Doc du Sport | 25 mai 2021
Doc du Sport | 25 mai 2021
-
 Dr Marc Rozenblat | 27 mai 2021
Dr Marc Rozenblat | 27 mai 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 3 juin 2021
Dr Stéphane Cascua | 3 juin 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 8 juin 2021
Dr Stéphane Cascua | 8 juin 2021
-
 Doc du Sport | 10 juin 2021
Doc du Sport | 10 juin 2021
-
 Anne Odru | 17 juin 2021
Anne Odru | 17 juin 2021
-
 Anne Odru | 22 juin 2021
Anne Odru | 22 juin 2021
-
 Anne Odru | 24 juin 2021
Anne Odru | 24 juin 2021
Pascal Pich: « J’ai besoin de me fixer des objectifs de dingos! »
-
 Dr Stéphane Cascua | 29 juin 2021
Dr Stéphane Cascua | 29 juin 2021
-
 Doc du Sport | 1 juillet 2021
Doc du Sport | 1 juillet 2021
-
 Doc du Sport | 6 juillet 2021
Doc du Sport | 6 juillet 2021
-
 Doc du Sport | 8 juillet 2021
Doc du Sport | 8 juillet 2021
-
 Baptiste Nobilet | 13 juillet 2021
Baptiste Nobilet | 13 juillet 2021
-
 Anne Odru | 15 juillet 2021
Anne Odru | 15 juillet 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 22 juillet 2021
Dr Stéphane Cascua | 22 juillet 2021
-
 Gregory | 27 juillet 2021
Gregory | 27 juillet 2021
Fatigue en trail: interactions entre le sexe et la distance de course
-
 Doc du Sport | 29 juillet 2021
Doc du Sport | 29 juillet 2021
-
 Gregory | 3 août 2021
Gregory | 3 août 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 5 août 2021
Dr Stéphane Cascua | 5 août 2021
-
 Doc du Sport | 10 août 2021
Doc du Sport | 10 août 2021
-
 Anne Odru | 12 août 2021
Anne Odru | 12 août 2021
-
 Doc du Sport | 19 août 2021
Doc du Sport | 19 août 2021
-
 Doc du Sport | 24 août 2021
Doc du Sport | 24 août 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 26 août 2021
Dr Stéphane Cascua | 26 août 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 31 août 2021
Dr Stéphane Cascua | 31 août 2021
-
 Philippe Chaduteau | 9 septembre 2021
Philippe Chaduteau | 9 septembre 2021
Hypertension artérielle: l’activité physique et sportive comme médicament
-
 Dr Stéphane Cascua | 21 octobre 2021
Dr Stéphane Cascua | 21 octobre 2021
-
 Doc du Sport | 25 octobre 2021
Doc du Sport | 25 octobre 2021
-
 Anne Odru | 27 octobre 2021
Anne Odru | 27 octobre 2021
Nathalie Dechy: « quand on aime le tennis, c’est pour la vie! »
-
 Anne Odru | 29 octobre 2021
Anne Odru | 29 octobre 2021
-
 Doc du Sport | 1 novembre 2021
Doc du Sport | 1 novembre 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 3 novembre 2021
Dr Stéphane Cascua | 3 novembre 2021
-
 Doc du Sport | 5 novembre 2021
Doc du Sport | 5 novembre 2021
Sport et maternité: un guide pour accompagner les femmes dans leurs pratiques
-
 Dr Stéphane Cascua | 8 novembre 2021
Dr Stéphane Cascua | 8 novembre 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 10 novembre 2021
Dr Stéphane Cascua | 10 novembre 2021
-
 Anne Odru | 12 novembre 2021
Anne Odru | 12 novembre 2021
Femme + équitation: l’équilibre au service du bien-être pour la famille
-
 Anne Odru | 15 novembre 2021
Anne Odru | 15 novembre 2021
-
 Anne Odru | 17 novembre 2021
Anne Odru | 17 novembre 2021
-
 Anne Odru | 19 novembre 2021
Anne Odru | 19 novembre 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 22 novembre 2021
Dr Stéphane Cascua | 22 novembre 2021
Mal au dos: la natation, c’est bien… Mais c’est insuffisant!
-
 Doc du Sport | 24 novembre 2021
Doc du Sport | 24 novembre 2021
-
 Dr Stéphane Cascua | 26 novembre 2021
Dr Stéphane Cascua | 26 novembre 2021
-
 Anne Odru | 30 novembre 2021
Anne Odru | 30 novembre 2021
Frédéric Compagnon: « Le soutien sur le Marathon des Sables est exceptionnel »
-
 Anne Odru | 2 décembre 2021
Anne Odru | 2 décembre 2021
-
 Anne Odru | 7 décembre 2021
Anne Odru | 7 décembre 2021
-
 Doc du Sport | 9 décembre 2021
Doc du Sport | 9 décembre 2021
-
 Anne Odru | 14 décembre 2021
Anne Odru | 14 décembre 2021
Roxana Maracineanu : « Le sport doit faire partie de la vie et la vie doit faire partie du sport. »
-
 Dr Stéphane Cascua | 16 décembre 2021
Dr Stéphane Cascua | 16 décembre 2021
Fréquence cardiaque: de l’imprécision pour plus de rigueur !
-
 Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2021
Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2021
-
 Gregory | 22 décembre 2021
Gregory | 22 décembre 2021
Entraînements et bien-être : ne zappez plus les étirements !
-
 Dr Stéphane Cascua | 27 décembre 2021
Dr Stéphane Cascua | 27 décembre 2021
-
 Anne Odru | 29 décembre 2021
Anne Odru | 29 décembre 2021
-
 Doc du Sport | 4 janvier 2022
Doc du Sport | 4 janvier 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 11 janvier 2022
Dr Stéphane Cascua | 11 janvier 2022
-
 Anne Odru | 18 janvier 2022
Anne Odru | 18 janvier 2022
-
 Muriel Hatem | 20 janvier 2022
Muriel Hatem | 20 janvier 2022
-
 Anne Odru | 9 février 2022
Anne Odru | 9 février 2022
-
 Doc du Sport | 16 février 2022
Doc du Sport | 16 février 2022
-
 Gregory | 24 février 2022
Gregory | 24 février 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 8 mars 2022
Dr Stéphane Cascua | 8 mars 2022
- Dr Bruno Emram | 9 mars 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 15 mars 2022
Dr Stéphane Cascua | 15 mars 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 22 mars 2022
Dr Stéphane Cascua | 22 mars 2022
-
 Doc du Sport | 29 mars 2022
Doc du Sport | 29 mars 2022
-
 Doc du Sport | 14 avril 2022
Doc du Sport | 14 avril 2022
-
 Anne Odru | 19 avril 2022
Anne Odru | 19 avril 2022
-
 Doc du Sport | 21 avril 2022
Doc du Sport | 21 avril 2022
-
 Doc du Sport | 26 avril 2022
Doc du Sport | 26 avril 2022
-
 Anne Odru | 28 avril 2022
Anne Odru | 28 avril 2022
-
 Doc du Sport | 3 mai 2022
Doc du Sport | 3 mai 2022
-
 Anne Odru | 5 mai 2022
Anne Odru | 5 mai 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 10 mai 2022
Dr Stéphane Cascua | 10 mai 2022
-
 Doc du Sport | 12 mai 2022
Doc du Sport | 12 mai 2022
-
 Doc du Sport | 17 mai 2022
Doc du Sport | 17 mai 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 19 mai 2022
Dr Stéphane Cascua | 19 mai 2022
-
 Anne Odru | 24 mai 2022
Anne Odru | 24 mai 2022
-
 Doc du Sport | 26 mai 2022
Doc du Sport | 26 mai 2022
Peut-on jouer au golf lorsque l’on est insuffisant cardiaque?
-
 Anne Odru | 2 juin 2022
Anne Odru | 2 juin 2022
-
 Doc du Sport | 7 juin 2022
Doc du Sport | 7 juin 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 9 juin 2022
Dr Stéphane Cascua | 9 juin 2022
-
 Doc du Sport | 14 juin 2022
Doc du Sport | 14 juin 2022
-
 Anne Odru | 16 juin 2022
Anne Odru | 16 juin 2022
-
 Doc du Sport | 21 juin 2022
Doc du Sport | 21 juin 2022
-
 Anne Odru | 23 juin 2022
Anne Odru | 23 juin 2022
-
 Doc du Sport | 28 juin 2022
Doc du Sport | 28 juin 2022
-
 Doc du Sport | 30 juin 2022
Doc du Sport | 30 juin 2022
Natation et activité physique adaptée à la grossesse au premier trimestre
-
 Doc du Sport | 12 juillet 2022
Doc du Sport | 12 juillet 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 14 juillet 2022
Dr Stéphane Cascua | 14 juillet 2022
-
 Doc du Sport | 4 août 2022
Doc du Sport | 4 août 2022
-
 Anne Odru | 9 août 2022
Anne Odru | 9 août 2022
Laetitia Bernard: « J’ai à la fois une pratique sportive et cyclotouriste. »
-
 Dr Stéphane Cascua | 11 août 2022
Dr Stéphane Cascua | 11 août 2022
- Doc du Sport | 16 août 2022
-
 Doc du Sport | 18 août 2022
Doc du Sport | 18 août 2022
-
 Doc du Sport | 23 août 2022
Doc du Sport | 23 août 2022
-
 Doc du Sport | 25 août 2022
Doc du Sport | 25 août 2022
-
 Doc du Sport | 30 août 2022
Doc du Sport | 30 août 2022
-
 Doc du Sport | 10 octobre 2022
Doc du Sport | 10 octobre 2022
-
 Doc du Sport | 11 octobre 2022
Doc du Sport | 11 octobre 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 20 octobre 2022
Dr Stéphane Cascua | 20 octobre 2022
-
 Doc du Sport | 21 octobre 2022
Doc du Sport | 21 octobre 2022
-
 Doc du Sport | 27 octobre 2022
Doc du Sport | 27 octobre 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 2 novembre 2022
Dr Stéphane Cascua | 2 novembre 2022
-
 Anne Odru | 15 novembre 2022
Anne Odru | 15 novembre 2022
Les troubles musculo-squelettiques: pathologies les plus fréquentes en endurance
-
 Anne Odru | 18 novembre 2022
Anne Odru | 18 novembre 2022
-
 Anne Odru | 22 novembre 2022
Anne Odru | 22 novembre 2022
-
 Anne Odru | 24 novembre 2022
Anne Odru | 24 novembre 2022
-
 Anne Odru | 29 novembre 2022
Anne Odru | 29 novembre 2022
-
 Anne Odru | 1 décembre 2022
Anne Odru | 1 décembre 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 6 décembre 2022
Dr Stéphane Cascua | 6 décembre 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 8 décembre 2022
Dr Stéphane Cascua | 8 décembre 2022
-
 Dr Stéphane Cascua | 13 décembre 2022
Dr Stéphane Cascua | 13 décembre 2022
-
 Doc du Sport | 15 décembre 2022
Doc du Sport | 15 décembre 2022
-
 Anne Odru | 20 décembre 2022
Anne Odru | 20 décembre 2022
-
 Anne Odru | 22 décembre 2022
Anne Odru | 22 décembre 2022
-
 Doc du Sport | 3 janvier 2023
Doc du Sport | 3 janvier 2023
-
 Anne Odru | 5 janvier 2023
Anne Odru | 5 janvier 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 10 janvier 2023
Dr Stéphane Cascua | 10 janvier 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 12 janvier 2023
Dr Stéphane Cascua | 12 janvier 2023
-
 Anne Odru | 17 janvier 2023
Anne Odru | 17 janvier 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 19 janvier 2023
Dr Stéphane Cascua | 19 janvier 2023
-
 Anne Odru | 24 janvier 2023
Anne Odru | 24 janvier 2023
-
 Anne Odru | 26 janvier 2023
Anne Odru | 26 janvier 2023
-
 Doc du Sport | 31 janvier 2023
Doc du Sport | 31 janvier 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 2 février 2023
Dr Stéphane Cascua | 2 février 2023
La commotion cérébrale au ski: une amnésie à ne pas oublier !
-
 Dr Stéphane Cascua | 7 février 2023
Dr Stéphane Cascua | 7 février 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 9 février 2023
Dr Stéphane Cascua | 9 février 2023
-
 Doc du Sport | 14 février 2023
Doc du Sport | 14 février 2023
-
 Doc du Sport | 16 février 2023
Doc du Sport | 16 février 2023
Aurélien Ducroz : « La mer m’a aidé à devenir meilleur skieur »
-
 Anne Odru | 21 février 2023
Anne Odru | 21 février 2023
Marie-Laure Brunet: « le biathlon m’a aidée à me structurer »
-
 Anne Odru | 23 février 2023
Anne Odru | 23 février 2023
Le tennis sous toutes ses formes, une multipratique accessible à tous
-
 Anne Odru | 28 février 2023
Anne Odru | 28 février 2023
-
 Doc du Sport | 18 avril 2023
Doc du Sport | 18 avril 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 20 avril 2023
Dr Stéphane Cascua | 20 avril 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 25 avril 2023
Dr Stéphane Cascua | 25 avril 2023
-
 Anne Odru | 27 avril 2023
Anne Odru | 27 avril 2023
-
 Anne Odru | 9 mai 2023
Anne Odru | 9 mai 2023
Yohan Durand: « Le Marathon de Paris 2024 serait l’aboutissement de ma carrière »
-
 Doc du Sport | 11 mai 2023
Doc du Sport | 11 mai 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 16 mai 2023
Dr Stéphane Cascua | 16 mai 2023
-
 Doc du Sport | 18 mai 2023
Doc du Sport | 18 mai 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 25 mai 2023
Dr Stéphane Cascua | 25 mai 2023
-
 Doc du Sport | 30 mai 2023
Doc du Sport | 30 mai 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 1 juin 2023
Dr Stéphane Cascua | 1 juin 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 6 juin 2023
Dr Stéphane Cascua | 6 juin 2023
-
 Doc du Sport | 8 juin 2023
Doc du Sport | 8 juin 2023
-
 Doc du Sport | 13 juin 2023
Doc du Sport | 13 juin 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 15 juin 2023
Dr Stéphane Cascua | 15 juin 2023
-
 Doc du Sport | 22 juin 2023
Doc du Sport | 22 juin 2023
-
 Doc du Sport | 13 juillet 2023
Doc du Sport | 13 juillet 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 18 juillet 2023
Dr Stéphane Cascua | 18 juillet 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 20 juillet 2023
Dr Stéphane Cascua | 20 juillet 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 25 juillet 2023
Dr Stéphane Cascua | 25 juillet 2023
Protéines navettes, lipomax, mécanome : la rando devient prépa physique
-
 Doc du Sport | 27 juillet 2023
Doc du Sport | 27 juillet 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 12 septembre 2023
Dr Stéphane Cascua | 12 septembre 2023
Le parcours de musculation: le renforcement pour votre endurance
-
 Anne Odru | 14 septembre 2023
Anne Odru | 14 septembre 2023
-
 Doc du Sport | 19 octobre 2023
Doc du Sport | 19 octobre 2023
-
 Doc du Sport | 24 octobre 2023
Doc du Sport | 24 octobre 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 26 octobre 2023
Dr Stéphane Cascua | 26 octobre 2023
L’arthropathie acromio-claviculaire : une blessure emblématique de la muscu
-
 Anne Odru | 31 octobre 2023
Anne Odru | 31 octobre 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 2 novembre 2023
Dr Stéphane Cascua | 2 novembre 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 7 novembre 2023
Dr Stéphane Cascua | 7 novembre 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 9 novembre 2023
Dr Stéphane Cascua | 9 novembre 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2023
Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 16 novembre 2023
Dr Stéphane Cascua | 16 novembre 2023
TRAIL: la douleur sur le côté du bassin, une blessure de devers…
-
 Anne Odru | 21 novembre 2023
Anne Odru | 21 novembre 2023
-
 Doc du Sport | 23 novembre 2023
Doc du Sport | 23 novembre 2023
-
 Anne Odru | 28 novembre 2023
Anne Odru | 28 novembre 2023
-
 Anne Odru | 30 novembre 2023
Anne Odru | 30 novembre 2023
-
 Doc du Sport | 14 décembre 2023
Doc du Sport | 14 décembre 2023
Courez le Schneider Electric Marathon de Paris avec un dossard solidaire !
-
 Doc du Sport | 19 décembre 2023
Doc du Sport | 19 décembre 2023
-
 Anne Odru | 21 décembre 2023
Anne Odru | 21 décembre 2023
-
 Dr Stéphane Cascua | 26 décembre 2023
Dr Stéphane Cascua | 26 décembre 2023
-
 Anne Odru | 28 décembre 2023
Anne Odru | 28 décembre 2023
-
 Doc du Sport | 2 janvier 2024
Doc du Sport | 2 janvier 2024
Les conseils pour se (re)mettre à une activité physique sans se blesser
-
 Anne Odru | 4 janvier 2024
Anne Odru | 4 janvier 2024
Bouge ! Ta Classe, un projet sportif et collaboratif en milieu scolaire
-
 Doc du Sport | 9 janvier 2024
Doc du Sport | 9 janvier 2024
-
Anne Odru | 30 janvier 2024
Nathalie Péchalat, une championne au service des enfants malades
-
 Dr Stéphane Cascua | 19 février 2024
Dr Stéphane Cascua | 19 février 2024
-
 Doc du Sport | 22 février 2024
Doc du Sport | 22 février 2024
Le ski de randonnée une pratique polymorphe pour des bienfaits multiples
-
 Doc du Sport | 27 février 2024
Doc du Sport | 27 février 2024
-
 Doc du Sport | 29 février 2024
Doc du Sport | 29 février 2024
La maladie d’Osgood-Schlatter,quand le genou est trop sollicité
-
 Dr Stéphane Cascua | 5 mars 2024
Dr Stéphane Cascua | 5 mars 2024
-
 Doc du Sport | 5 avril 2024
Doc du Sport | 5 avril 2024
Marathon pour Tous de Paris 2024 : la mythique épreuve des Jeux ouverte au grand public !
-
 Anne Odru | 9 avril 2024
Anne Odru | 9 avril 2024
-
 Anne Odru | 11 avril 2024
Anne Odru | 11 avril 2024
Julie ROBVEILLE : « J’ai préféré courir un marathon plutôt que de finir en chaise roulante »
-
 Dr Stéphane Cascua | 7 mai 2024
Dr Stéphane Cascua | 7 mai 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 9 mai 2024
Dr Stéphane Cascua | 9 mai 2024
-
 Anne Odru | 14 mai 2024
Anne Odru | 14 mai 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 16 mai 2024
Dr Stéphane Cascua | 16 mai 2024
Sportifs: connaissez-vous la poussée d’arthrose du sportif ?
-
 Doc du Sport | 21 mai 2024
Doc du Sport | 21 mai 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 23 mai 2024
Dr Stéphane Cascua | 23 mai 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 28 mai 2024
Dr Stéphane Cascua | 28 mai 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 20 juin 2024
Dr Stéphane Cascua | 20 juin 2024
-
 Doc du Sport | 9 juillet 2024
Doc du Sport | 9 juillet 2024
-
 Doc du Sport | 11 juillet 2024
Doc du Sport | 11 juillet 2024
-
 Doc du Sport | 16 juillet 2024
Doc du Sport | 16 juillet 2024
-
 Doc du Sport | 30 juillet 2024
Doc du Sport | 30 juillet 2024
-
 Muriel Hatem | 1 août 2024
Muriel Hatem | 1 août 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 6 août 2024
Dr Stéphane Cascua | 6 août 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 8 août 2024
Dr Stéphane Cascua | 8 août 2024
Après une blessure, les champions reprennent-ils plus vite ?
-
 Anne Odru | 13 août 2024
Anne Odru | 13 août 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 15 août 2024
Dr Stéphane Cascua | 15 août 2024
-
 Doc du Sport | 20 août 2024
Doc du Sport | 20 août 2024
-
 Anne Odru | 22 août 2024
Anne Odru | 22 août 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 27 août 2024
Dr Stéphane Cascua | 27 août 2024
-
 Anne Odru | 29 août 2024
Anne Odru | 29 août 2024
-
 Anne Odru | 30 août 2024
Anne Odru | 30 août 2024
Ultra-trail: l’hygiène de base vs nutrition pour éviter les troubles gastriques
-
 Anne Odru | 3 septembre 2024
Anne Odru | 3 septembre 2024
-
 Anne Odru | 5 septembre 2024
Anne Odru | 5 septembre 2024
L’épidémiologie travail de recherche sur les aspects gynécologiques en ultra-trail
-
 Dr Stéphane Cascua | 10 septembre 2024
Dr Stéphane Cascua | 10 septembre 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 22 octobre 2024
Dr Stéphane Cascua | 22 octobre 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 24 octobre 2024
Dr Stéphane Cascua | 24 octobre 2024
Syndrome de l’angulaire : quand la sportive souffre de l’immobilité !
-
 Anne Odru | 15 novembre 2024
Anne Odru | 15 novembre 2024
Amandine Ferrato : « L’idée est de faire mieux, pas de faire plus »
-
 Doc du Sport | 19 novembre 2024
Doc du Sport | 19 novembre 2024
L’hypothermie dans les activités outdoor, plus qu’un simple coup de froid !
-
 Dr Stéphane Cascua | 17 décembre 2024
Dr Stéphane Cascua | 17 décembre 2024
Le syndrome de la savonnette: une douleur de cheville chez le coureur
-
 Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2024
Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2024
-
 Anne Odru | 27 décembre 2024
Anne Odru | 27 décembre 2024
-
 Dr Stéphane Cascua | 17 janvier 2025
Dr Stéphane Cascua | 17 janvier 2025
-
 Dr Stéphane Cascua | 24 janvier 2025
Dr Stéphane Cascua | 24 janvier 2025
-
 Anne Odru | 28 janvier 2025
Anne Odru | 28 janvier 2025
-
 Dr Stéphane Cascua | 31 janvier 2025
Dr Stéphane Cascua | 31 janvier 2025
-
 Anne Odru | 4 février 2025
Anne Odru | 4 février 2025
-
 Doc du Sport | 7 février 2025
Doc du Sport | 7 février 2025
-
 Dr Stéphane Cascua | 11 février 2025
Dr Stéphane Cascua | 11 février 2025
-
 Doc du Sport | 18 février 2025
Doc du Sport | 18 février 2025
Les activités de glisse sur neige: développer ses capacités de perception et de contrôle moteur
-
 Doc du Sport | 21 février 2025
Doc du Sport | 21 février 2025
-
 Dr Stéphane Cascua | 25 février 2025
Dr Stéphane Cascua | 25 février 2025
-
 Muriel Hatem | 1 mars 2025
Muriel Hatem | 1 mars 2025
Major Mouvement : « Notre corps nous fournit gratuitement un remède, allons le chercher ! »
-
 Dr Stéphane Cascua | 4 mars 2025
Dr Stéphane Cascua | 4 mars 2025
-
 Muriel Hatem | 7 mars 2025
Muriel Hatem | 7 mars 2025
-
 Dr Stéphane Cascua | 11 mars 2025
Dr Stéphane Cascua | 11 mars 2025
-
 Doc du Sport | 14 mars 2025
Doc du Sport | 14 mars 2025
-
 Doc du Sport | 22 avril 2025
Doc du Sport | 22 avril 2025
Préparation mentale et marathon : l’arme fatale des finishers
-
 Dr Stéphane Cascua | 25 avril 2025
Dr Stéphane Cascua | 25 avril 2025
-
 Doc du Sport | 29 avril 2025
Doc du Sport | 29 avril 2025
Courir après 40 ans : comment optimiser sa performance et prévenir les blessures ?
-
 Doc du Sport | 10 juin 2025
Doc du Sport | 10 juin 2025
-
 Doc du Sport | 13 juin 2025
Doc du Sport | 13 juin 2025
Défaut de rotation interne de la hanche : et si c’était un conflit de hanche ?
-
 Doc du Sport | 18 juin 2025
Doc du Sport | 18 juin 2025
-
 Doc du Sport | 20 juin 2025
Doc du Sport | 20 juin 2025
-
 Anne Odru | 24 juin 2025
Anne Odru | 24 juin 2025
DECATHLON My Health : la solution qui personnalise votre nutrition
-
 Doc du Sport | 27 juin 2025
Doc du Sport | 27 juin 2025
Renforcez vos appuis : exercices de pieds pour un swing puissant et stable au golf
-
 Dr Stéphane Cascua | 1 juillet 2025
Dr Stéphane Cascua | 1 juillet 2025
-
 Doc du Sport | 4 juillet 2025
Doc du Sport | 4 juillet 2025
Prévalence de la scoliose chez l’adolescent pratiquant le golf de haut niveau
-
 Dr Stéphane Cascua | 8 juillet 2025
Dr Stéphane Cascua | 8 juillet 2025
-
 Doc du Sport | 11 juillet 2025
Doc du Sport | 11 juillet 2025
Ostéopathie et golf : un réel complément pour prévenir les blessures et contribuer à la performance
-
 Dr Stéphane Cascua | 25 juillet 2025
Dr Stéphane Cascua | 25 juillet 2025
-
 Doc du Sport | 29 juillet 2025
Doc du Sport | 29 juillet 2025
À quelle vitesse perd-on la forme physique ? Et comment ralentir le processus et récupérer ?
-
 Dr Stéphane Cascua | 1 août 2025
Dr Stéphane Cascua | 1 août 2025
-
 Doc du Sport | 5 août 2025
Doc du Sport | 5 août 2025
-
 Doc du Sport | 8 août 2025
Doc du Sport | 8 août 2025
-
 Doc du Sport | 12 août 2025
Doc du Sport | 12 août 2025
Votre pied est votre meilleur outil de randonnée : prenez-en soin, il vous mènera loin
- Doc du Sport | 15 août 2025
-
 Doc du Sport | 19 août 2025
Doc du Sport | 19 août 2025
-
 Dr Stéphane Cascua | 22 août 2025
Dr Stéphane Cascua | 22 août 2025
-
 Doc du Sport | 26 août 2025
Doc du Sport | 26 août 2025
-
 Doc du Sport | 18 novembre 2025
Doc du Sport | 18 novembre 2025
-
 Anne Odru | 14 novembre 2025
Anne Odru | 14 novembre 2025
-
 Dr Stéphane Cascua | 11 novembre 2025
Dr Stéphane Cascua | 11 novembre 2025
-
 Dr Stéphane Cascua | 7 novembre 2025
Dr Stéphane Cascua | 7 novembre 2025
-
 Doc du Sport | 4 novembre 2025
Doc du Sport | 4 novembre 2025
Pourquoi et comment faire du sport pour mieux vivre la ménopause ?
-
 Doc du Sport | 31 octobre 2025
Doc du Sport | 31 octobre 2025
-
 Dr Stéphane Cascua | 28 octobre 2025
Dr Stéphane Cascua | 28 octobre 2025
-
 Anne Odru | 24 octobre 2025
Anne Odru | 24 octobre 2025
-
 Doc du Sport | 21 octobre 2025
Doc du Sport | 21 octobre 2025
La préparation du pied en trail: un indispensable pour courir longtemps et sans détériorer sa foulée
-
 Anne Odru | 7 octobre 2025
Anne Odru | 7 octobre 2025
-
-
-
 Doc du Sport | 19 juin 2020
Doc du Sport | 19 juin 2020
-
 Dr Stéphane Cascua | 18 décembre 2018
Dr Stéphane Cascua | 18 décembre 2018
Tendinite et protocole de Stanish: des douleurs pour soigner vos tendons !
-
 Dr Marc Rozenblat | 9 janvier 2019
Dr Marc Rozenblat | 9 janvier 2019
Utilisation du plasma riche en plaquettes (PRP) en Traumatologie du Sport
-
 Dr Stéphane Cascua | 5 novembre 2019
Dr Stéphane Cascua | 5 novembre 2019
Entraînement – la séance au seuil: tout ce que vous devez connaître
-
 Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019
Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019
-
 Anne Odru | 14 janvier 2019
Anne Odru | 14 janvier 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019
Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019
Du gras pour maigrir et pour courir: le processus épigénétique
-
 Dr Stéphane Cascua | 11 octobre 2019
Dr Stéphane Cascua | 11 octobre 2019
-
 Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2019
Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2019
La brasse: une nage excellente pour votre condition physique
-
 Doc du Sport | 6 décembre 2019
Doc du Sport | 6 décembre 2019
-
 Doc du Sport | 18 novembre 2025
Doc du Sport | 18 novembre 2025
-
Copyright © Médiathlète




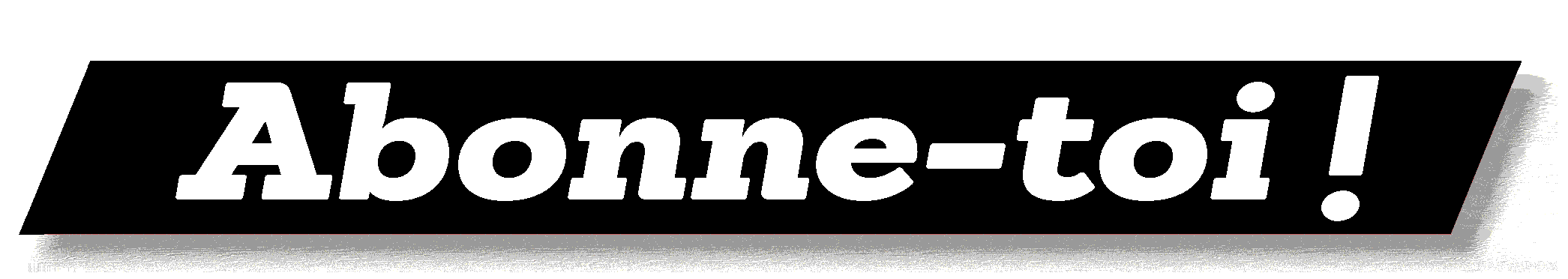

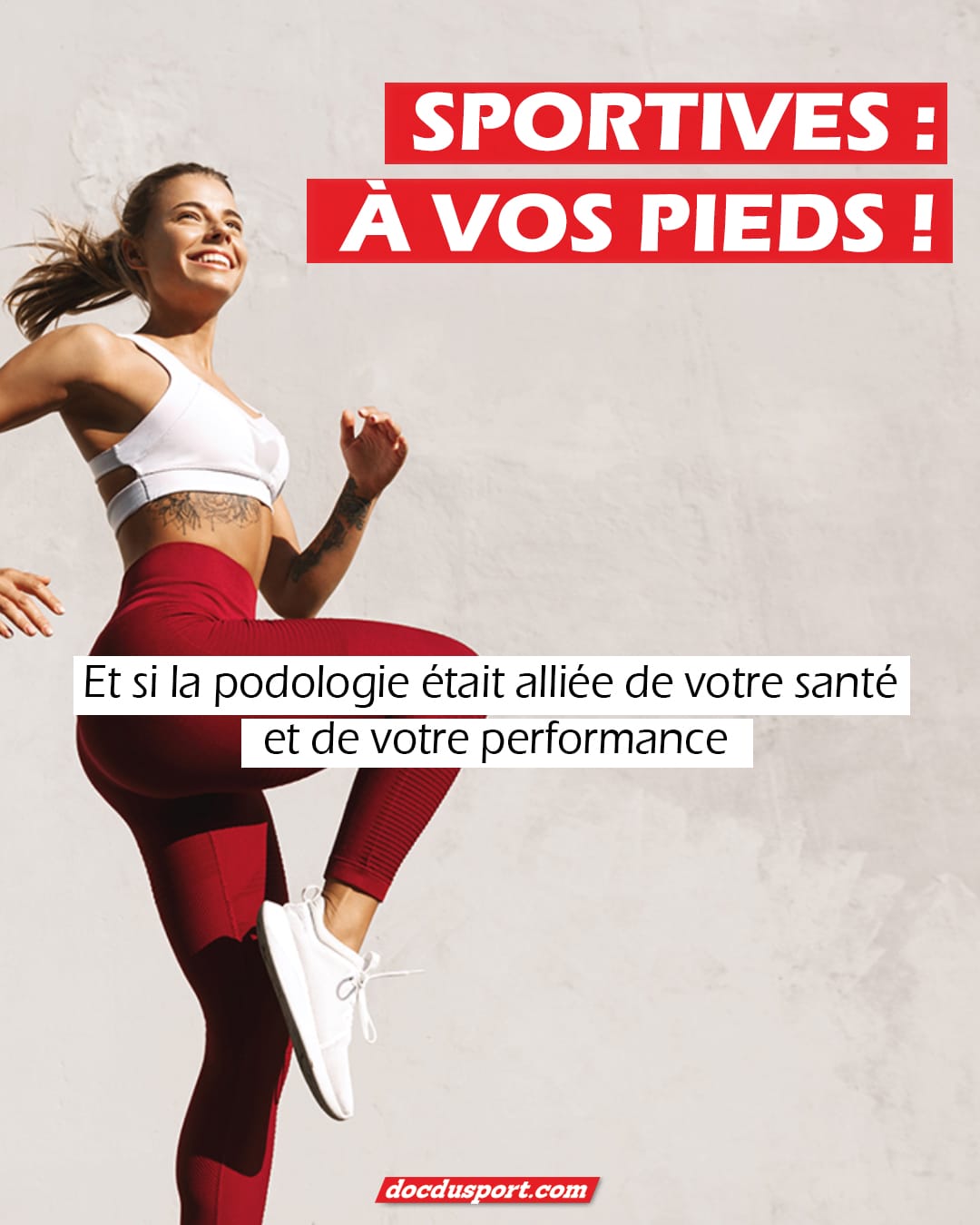
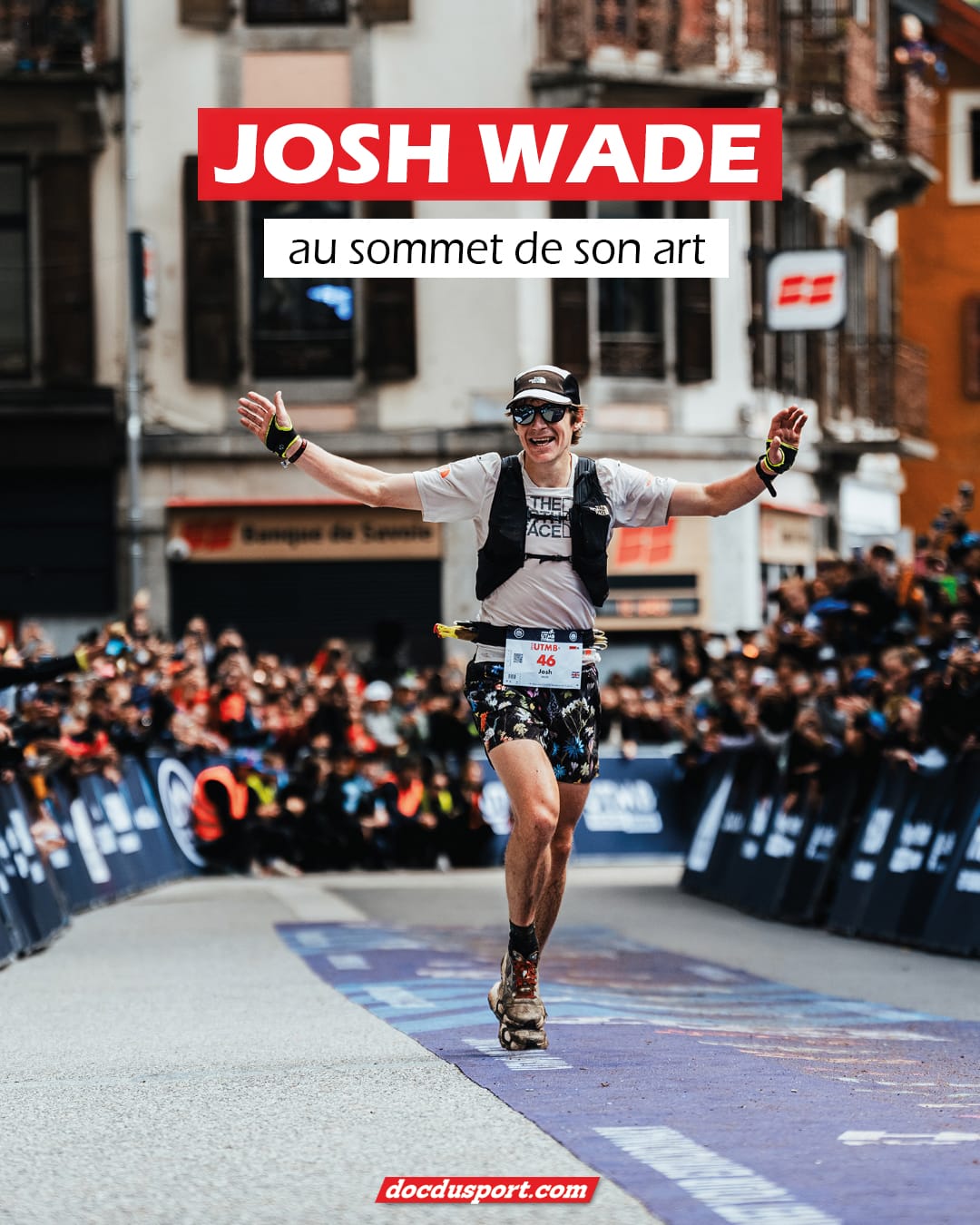
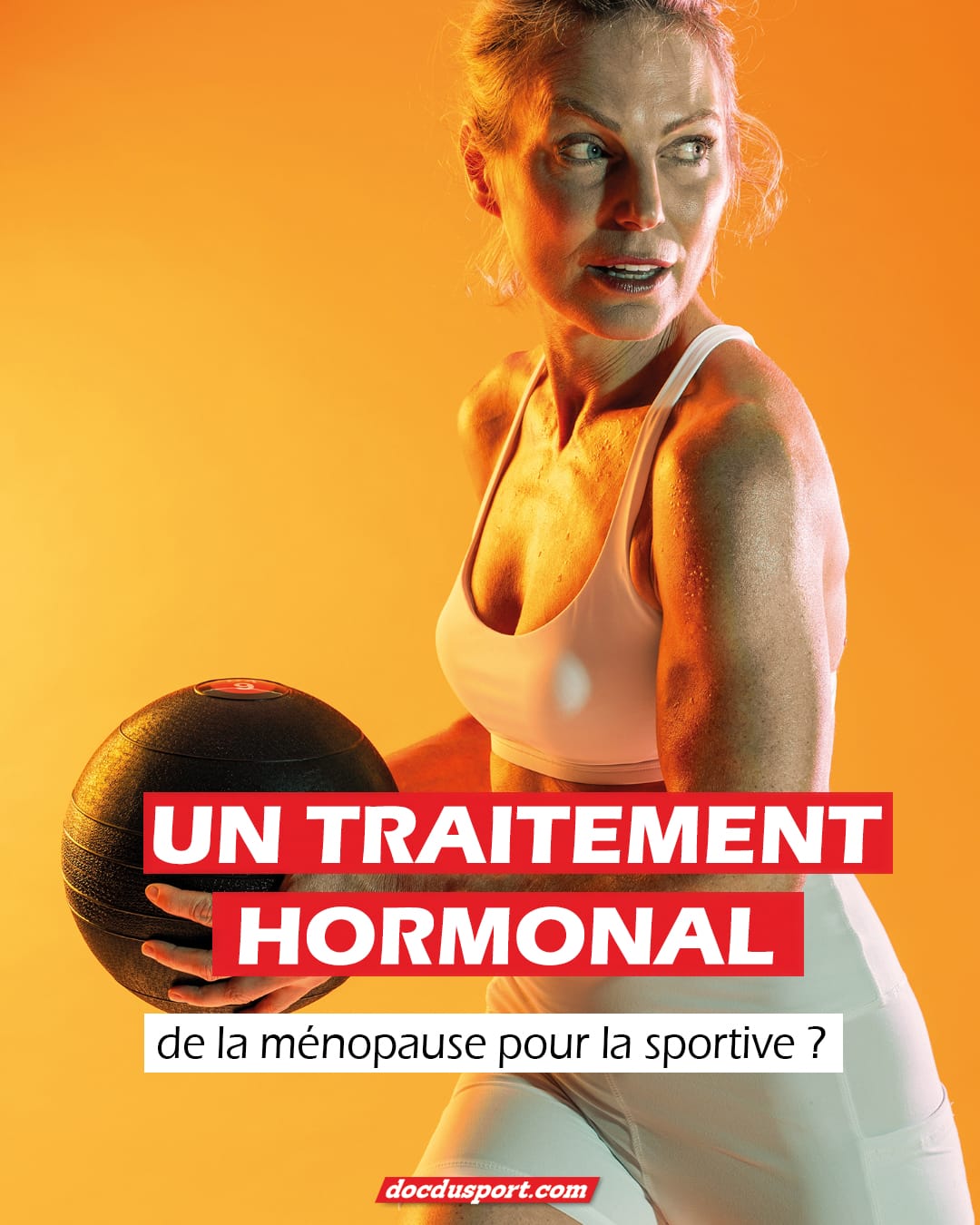
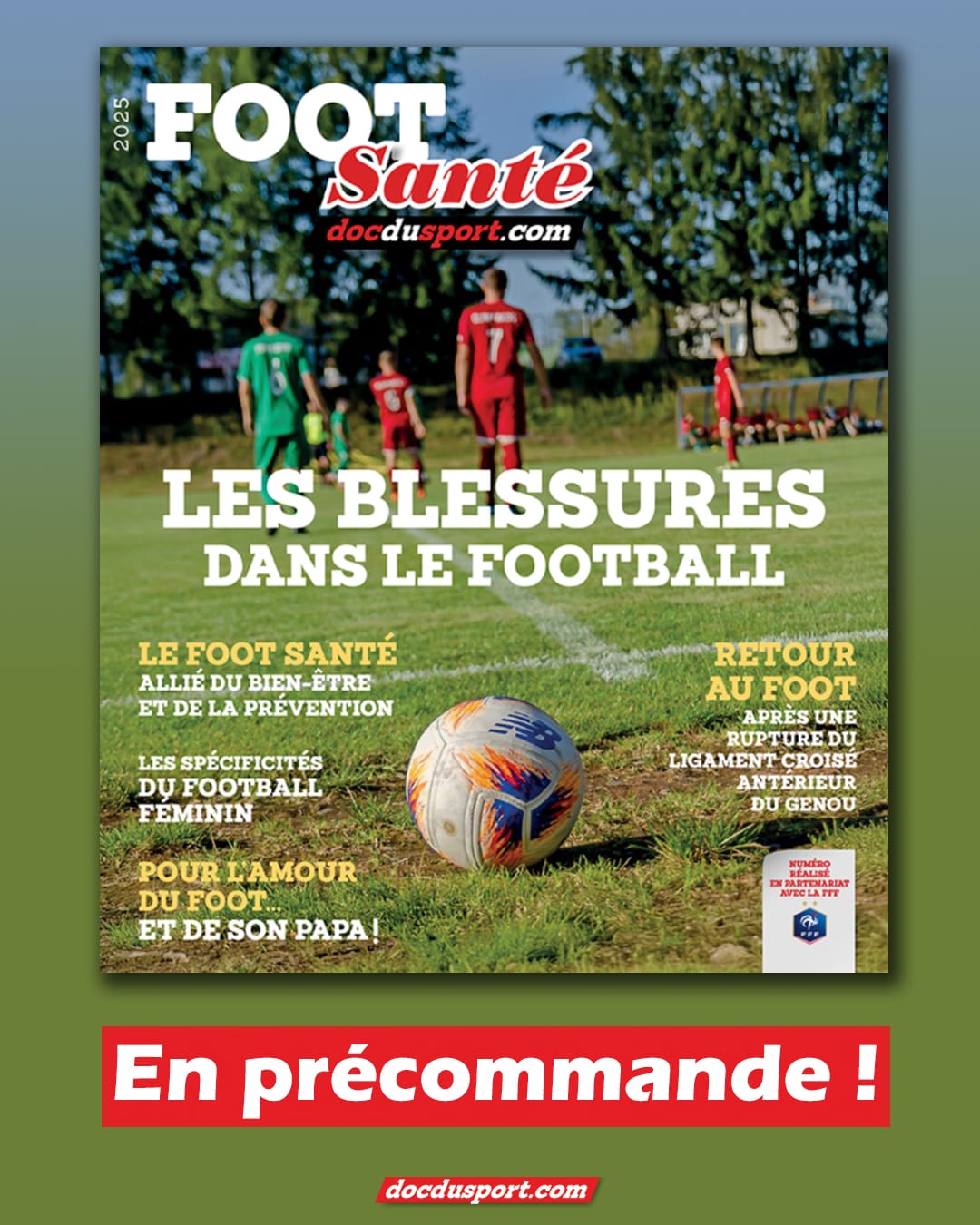

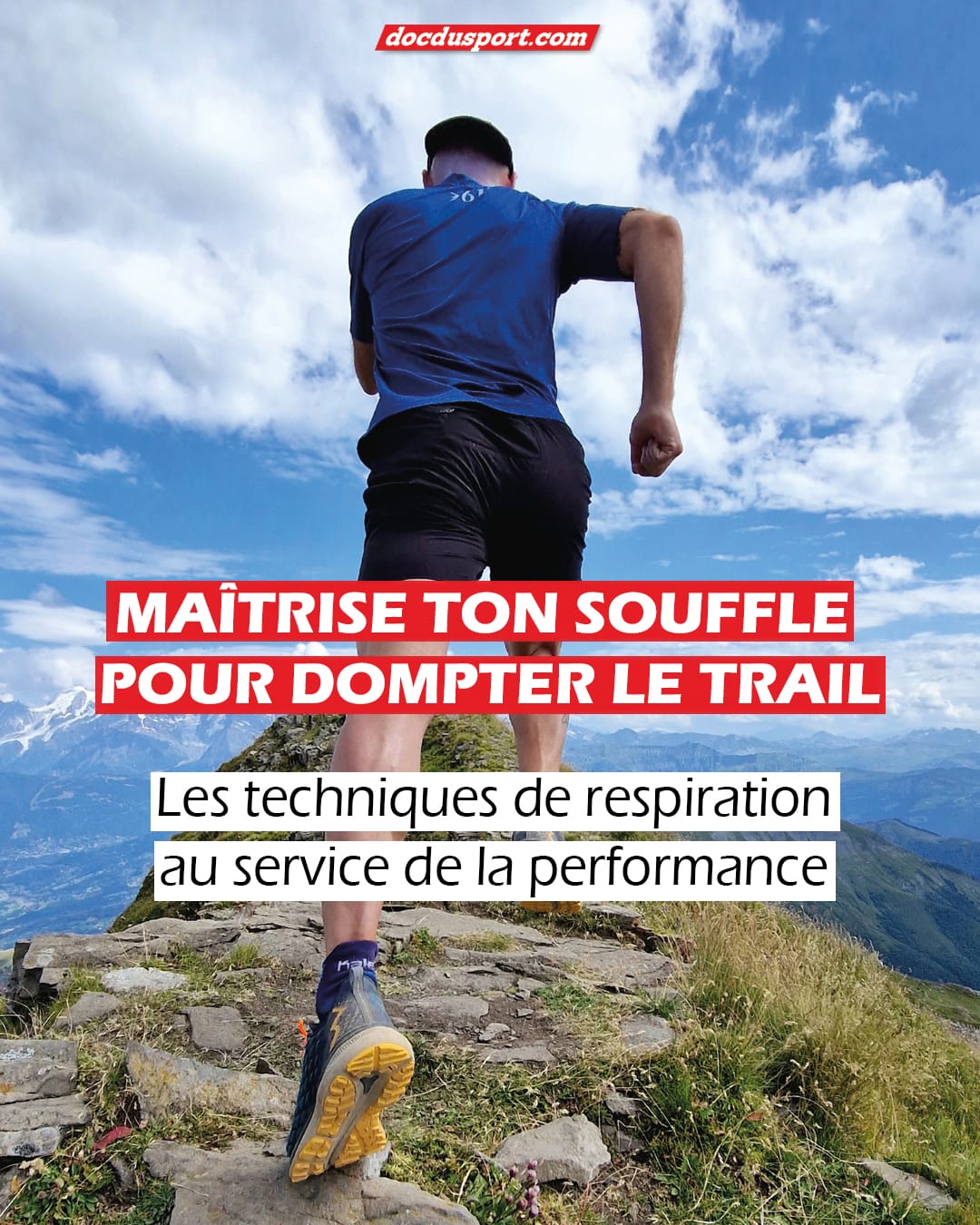
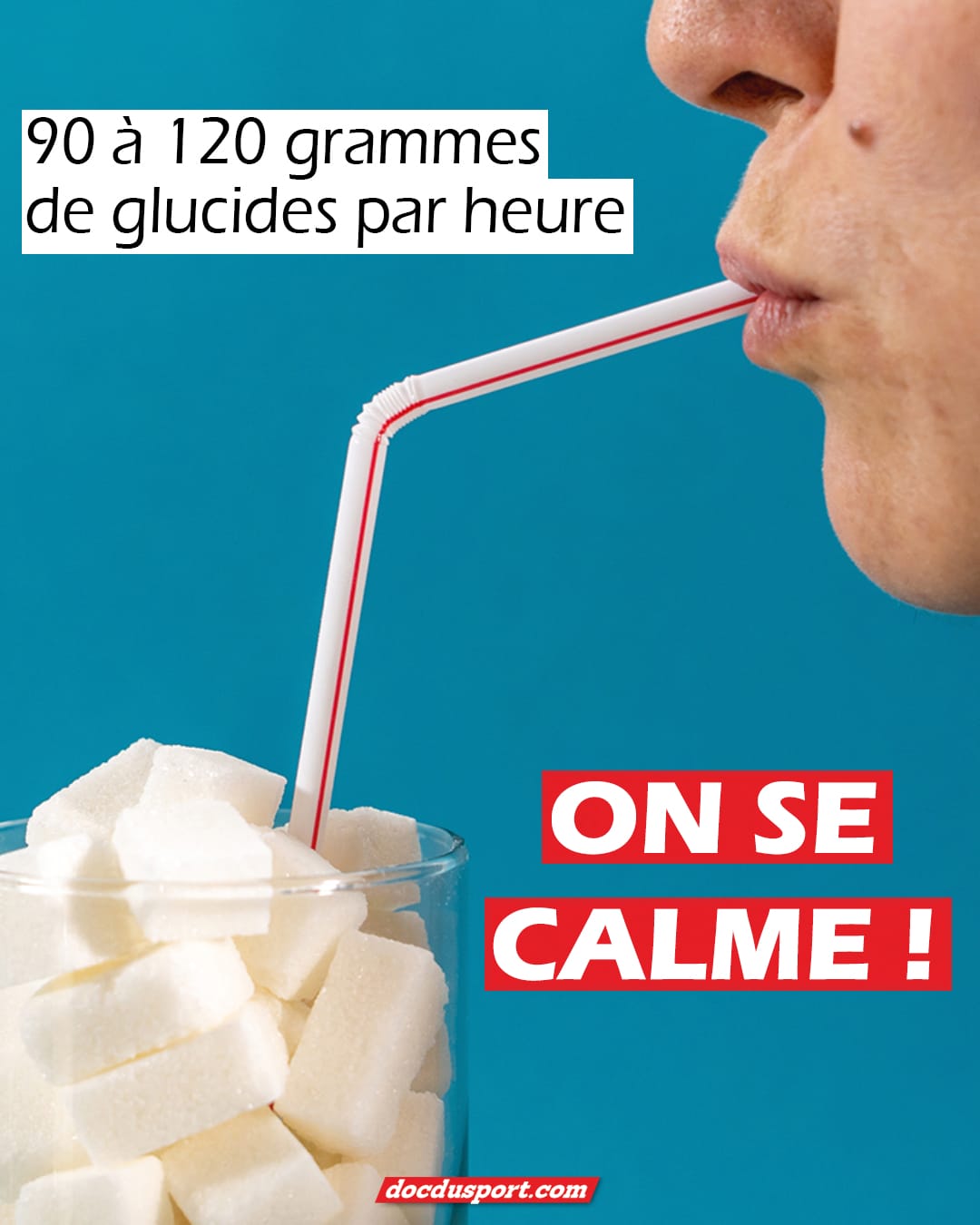

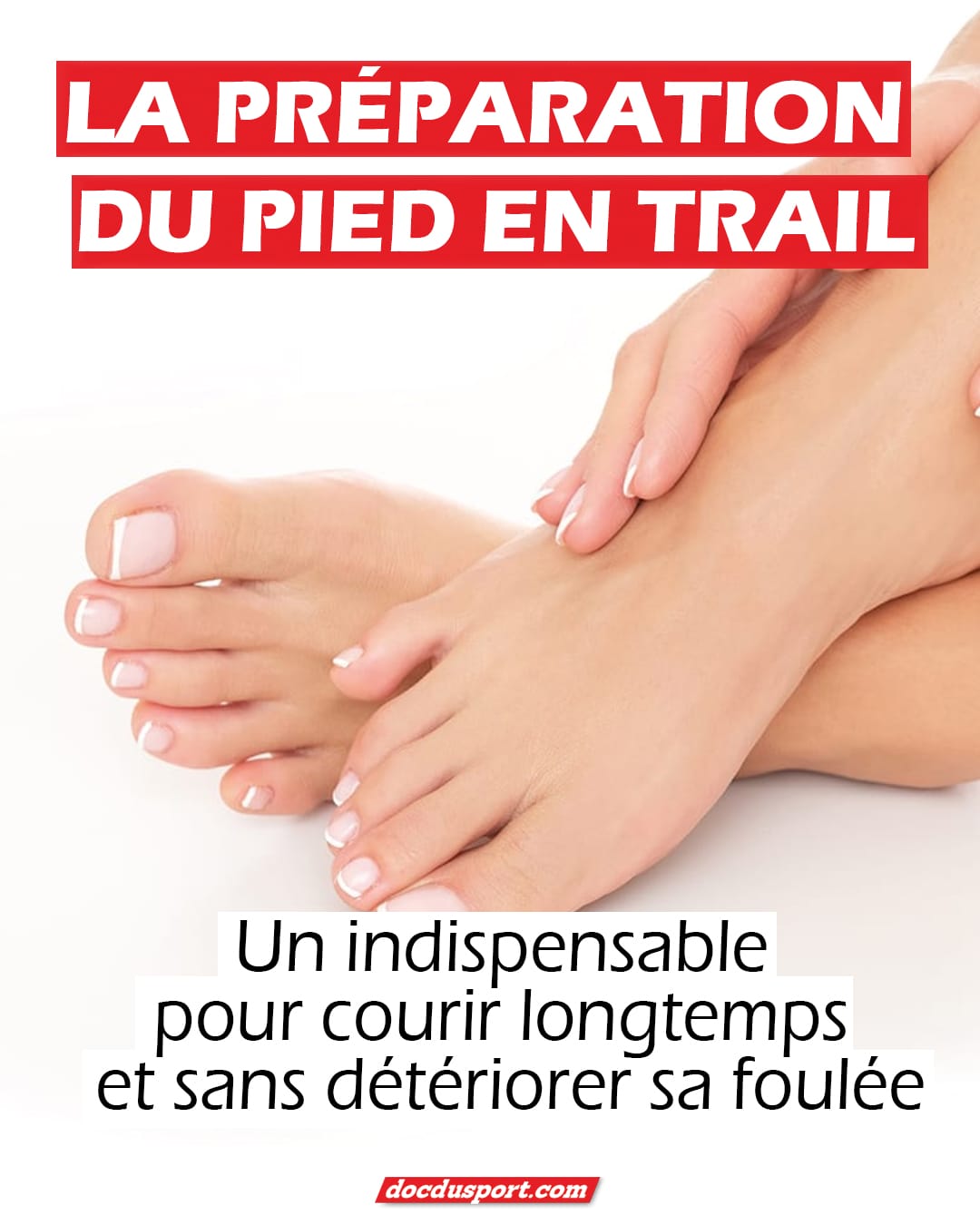

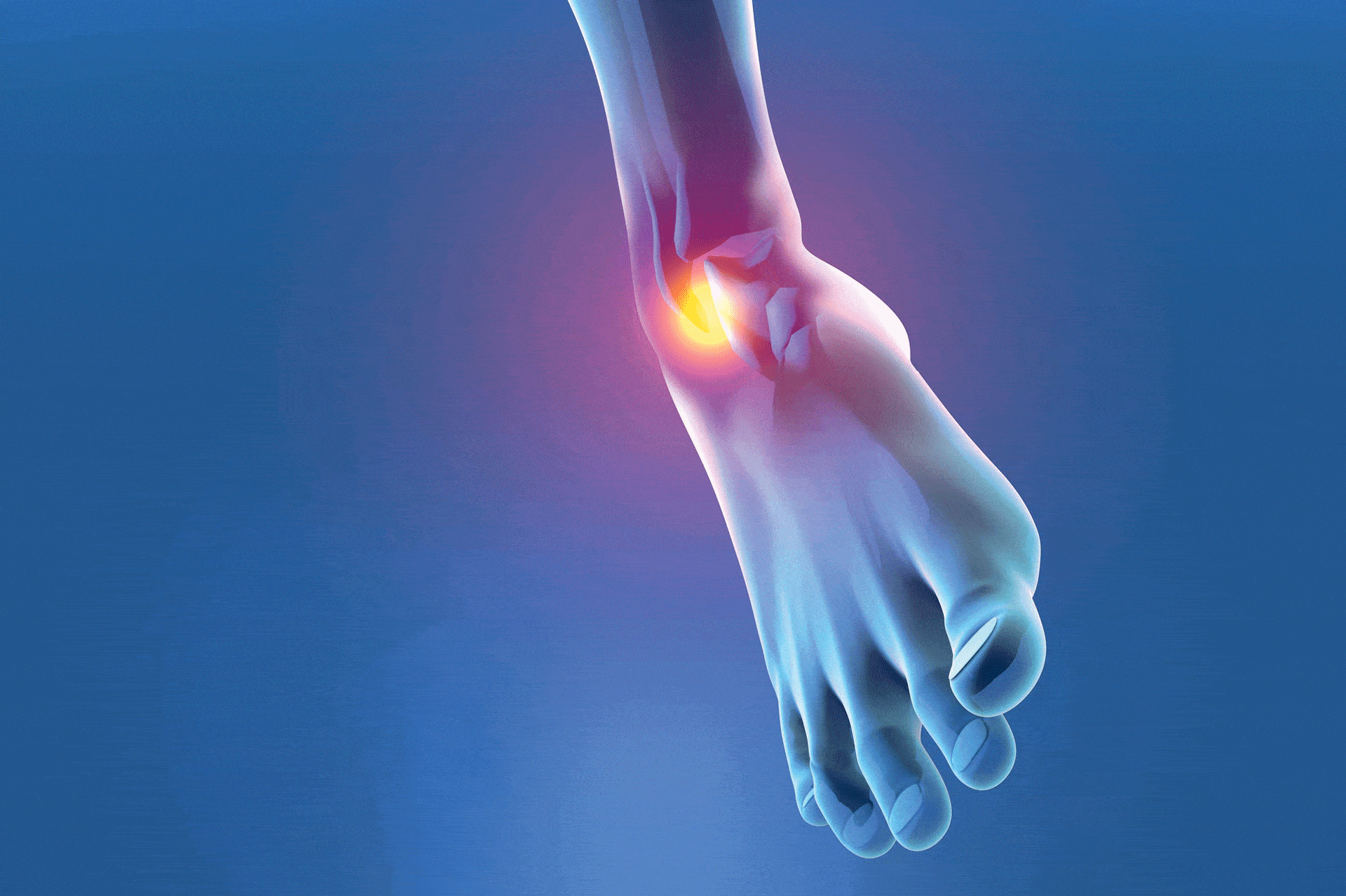















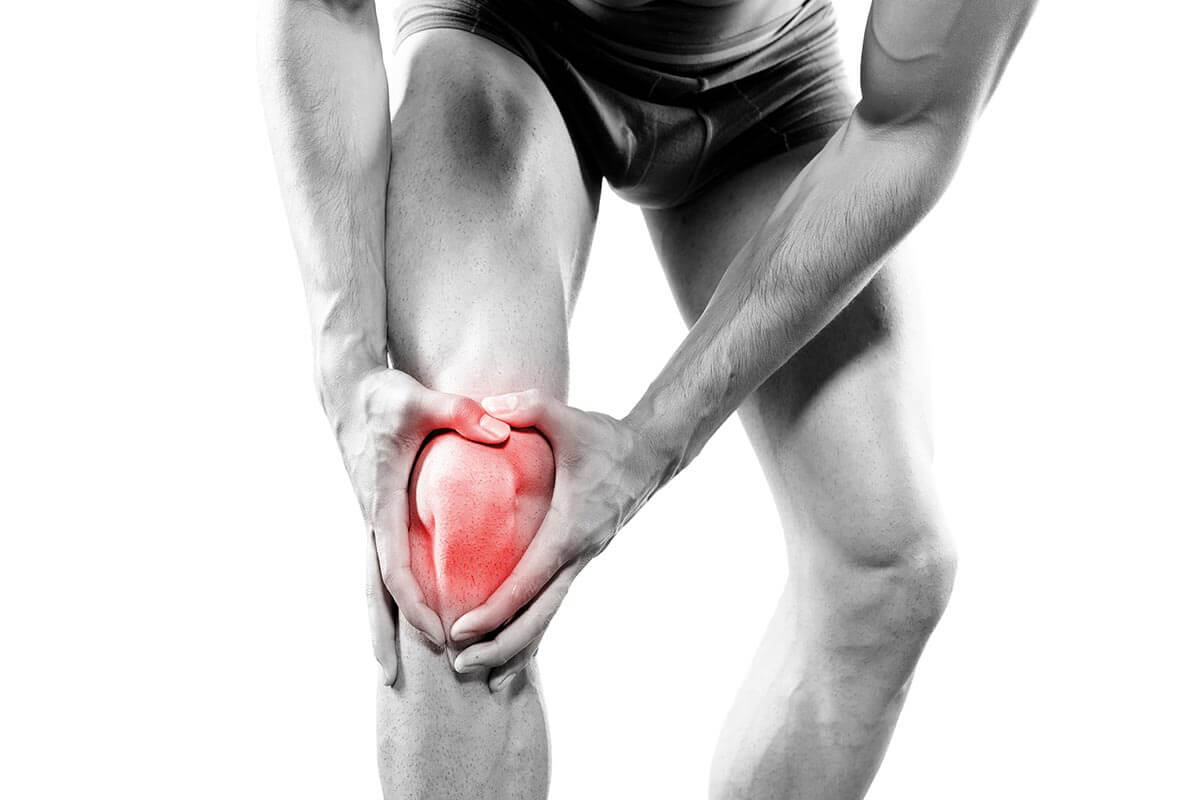




















































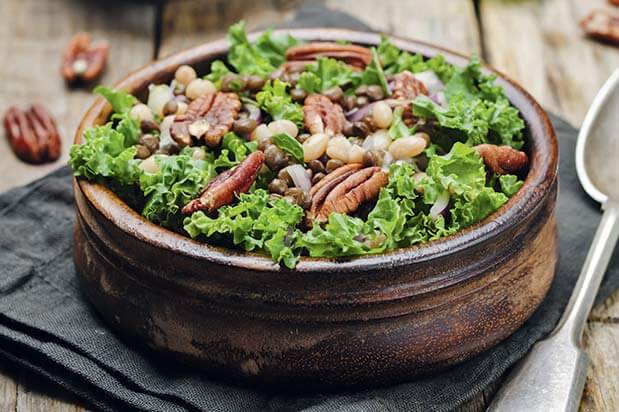














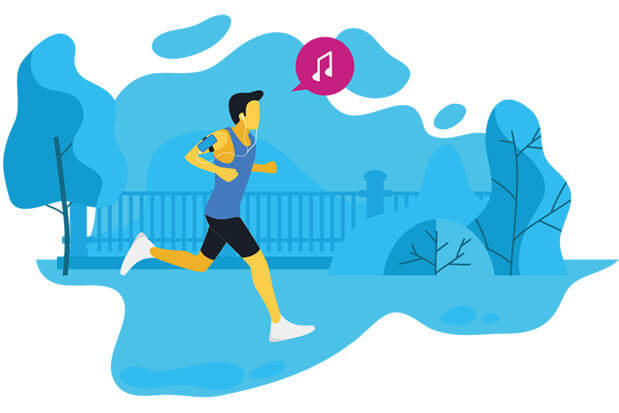









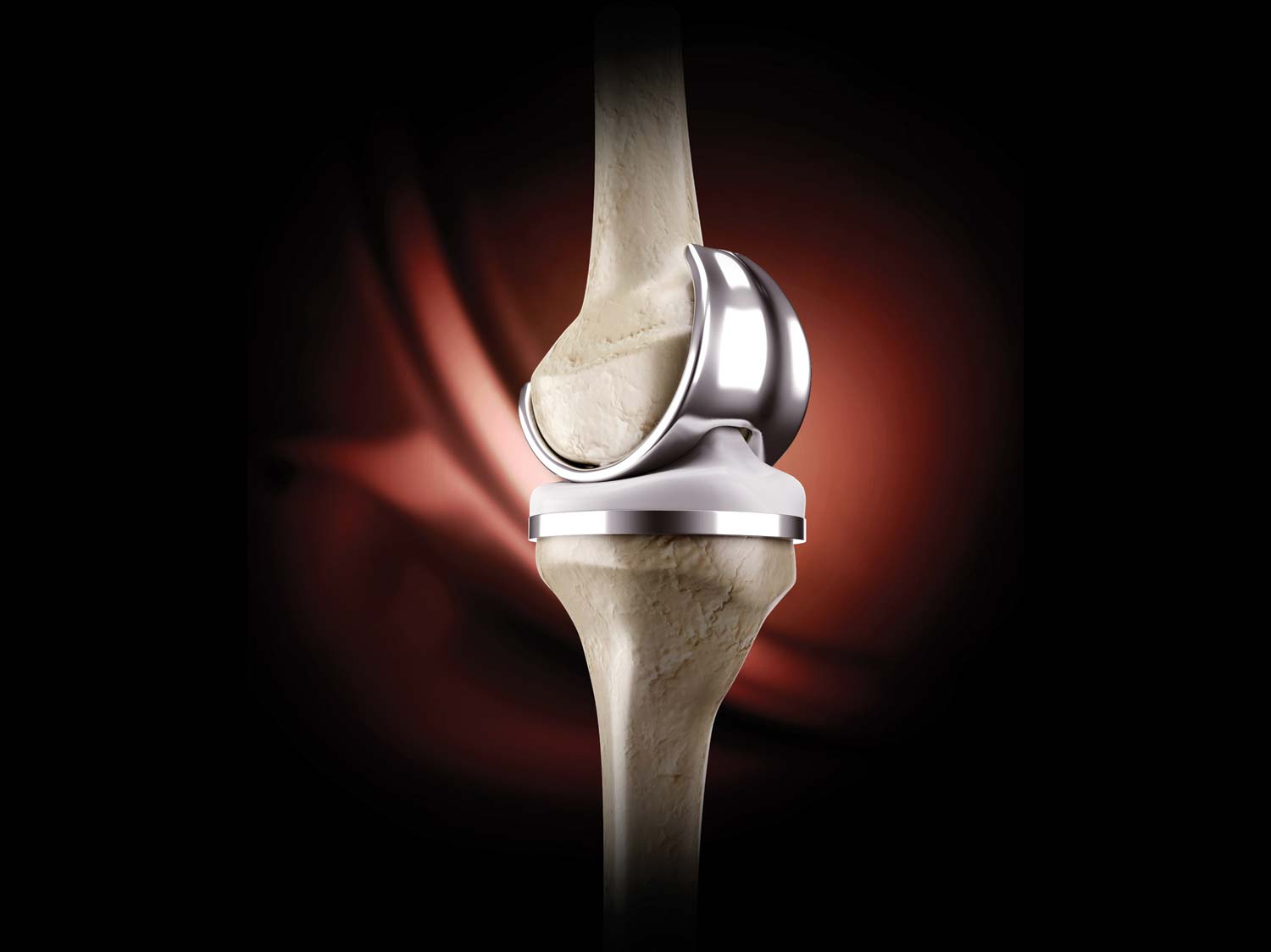
















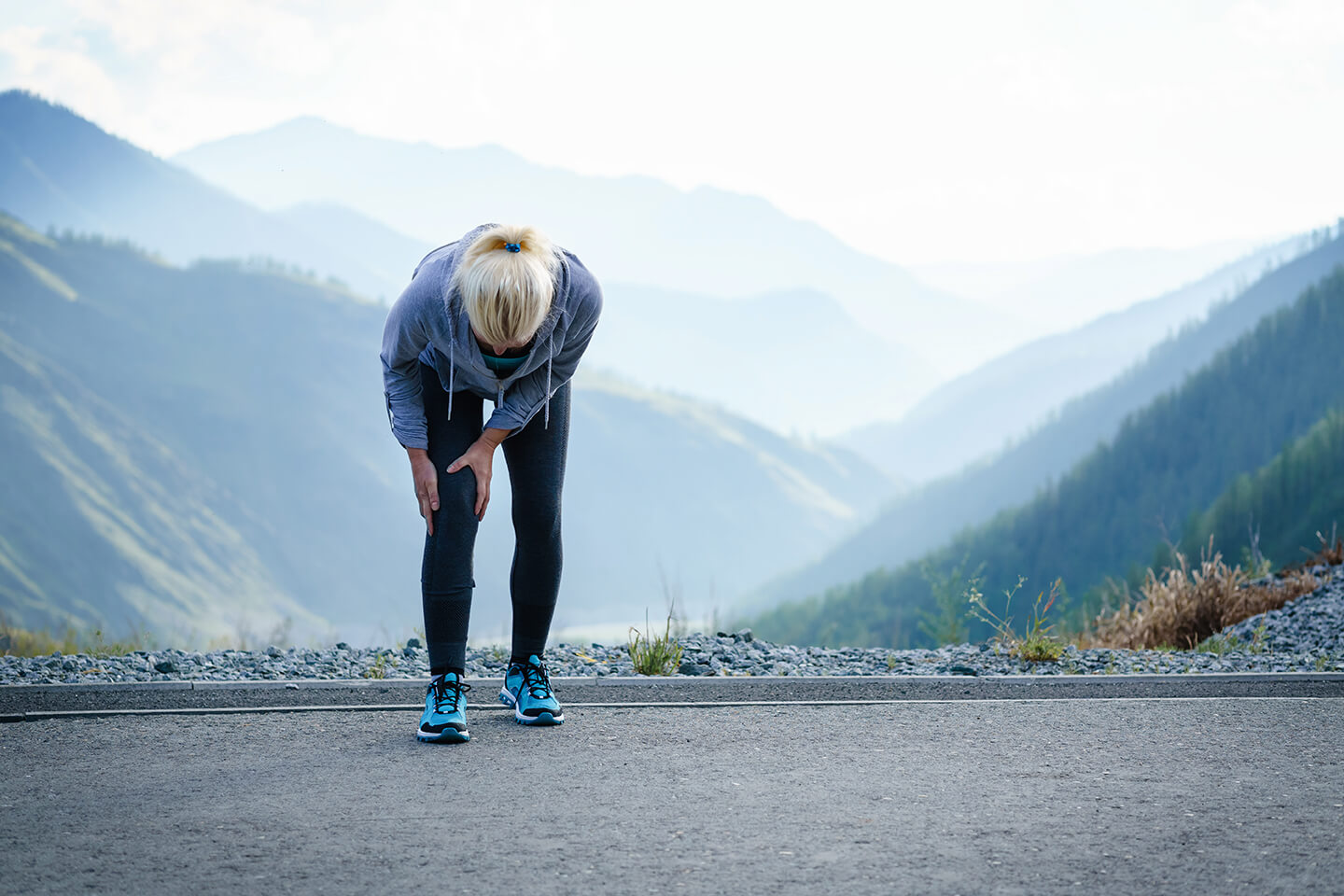



















































































































































































































































































































































































0 comments