Anatomie d’une chute

Les statistiques des assurances sont formelles et doivent nous interpeller : 70 % des chutes à vélo sont de notre simple responsabilité, qu’il s‘agisse de chute individuelle ou en groupe, l’élément déclencheur étant une erreur dans la conduite ou la perte de notre propre équilibre à vélo. Plus étonnant encore, la majorité des accidents surviennent en ligne droite ! Notre propos ne sera en aucun cas une arrière-pensée sécuritaire et encore moins culpabilisatrice, mais de tenter d’analyser ce qui nous rend si faillible. Pourtant, le sens commun l’affirme, faire du vélo ne s’oublie pas. Serait-ce encore une idée reçue ? Car si l‘Homo sapiens a appris pour se déplacer à marcher, courir, sauter, grimper, à nager pour survivre, la conception d’un engin à deux roues pour se déplacer ne date finalement que de deux siècles au maximum, voire sa réelle démocratisation ne date que d’un petit siècle. Alors, est-on si doué que cela pour tenir cet équilibre sur quelques cm2 ?
Par Patrice Delga, médecin fédéral
L‘équilibre ou la notion d’un espace vital indispensable
Pour tenir l ‘équilibre, il faut avancer. En principe, plus on va vite, plus l’équilibre est maîtrisable, et paradoxalement plus s’élargit autour de soi une zone d ‘incertitude ou un espace de survie. Cette zone est propre à chacun en fonction de sa pratique, de son expérience, de son âge, voire de sa témérité. Avec la vitesse qui augmente, la distance de freinage s’allonge et pourtant, l’équilibre est sûr à condition de ne pas avoir à changer de direction. La force centrifuge augmente avec la vitesse, le rayon de braquage se réduit d‘autant. Mais cette notion évidente en principe s’évalue très rapidement et est aisément bien maîtrisée. Il existe un espace virtuel de chaque côté du cycliste sur sa machine que l’on s’approprie de principe pour évoluer sereinement. Cet espace est plus ou moins important selon notre degré de pratique et notre forme physique. Le collègue qui n’a pas forcément la même appréciation de cet espace virtuel devient alors un intrus lorsqu’il franchit cette ligne virtuelle, il induit un sentiment d’incertitude susceptible d‘avoir un retentissement sur notre propre équilibre.
Un espace vital oui, mais à géométrie variable
Envisageons d’abord les cas extrêmes :
- La descente voit la zone d‘incertitude s‘allonger. La vitesse prise allonge la distance de freinage, l‘équilibre sur la machine reste cependant bien maîtrisé, la force centrifuge rend plus délicate la maîtrise des virages. Deux constats, les cyclistes gardent, en dehors de quelques « kamikazes », une distance suffisante entre eux pour pouvoir anticiper la réaction de celui qui précède. La notion de danger et l’angoisse de la chute avec des conséquences importantes exigent naturellement une concentration importante. En conclusion, les chutes sur route en descente liées à une erreur de trajectoire sont paradoxalement peu fréquentes en dehors des professionnels qui ont une prise de risque hors norme.
- En montée, c‘est exactement le contraire, la vitesse se réduit, donc l’équilibre sur la machine devient plus précaire. La zone de freinage utile est très courte, les cyclos peuvent se suivre en se « suçant » la roue. En revanche, latéralement, l’espace vital réclamé est en proportion plus large, les dépassements se font avec un écart un peu plus conséquent entre deux cyclistes que sur le plat, anticipant le « zigzag », le temps d‘arrêt même minime lors du passage en danseuse d’un des deux cyclos. En montée, finalement, les coups de gueule pour éviter les accrochages, voire les chutes individuelles, à vitesse modérée sont paradoxalement un peu plus fréquents qu’au cours de la descente, mais évidemment moins dangereux.
- Le vent : voilà un élément particulièrement néfaste à l’équilibre, qu’il soit de face ou surtout latéral, il exige une attention toute particulière. La zone d’incertitude devient prépondérante. L’équilibre est forcément plus délicat à maintenir, soumis aux variations parfois brutales de la force d’intensité du vent. Il faut néanmoins accepter de se résoudre à réduire cet espace vital à sa portion la plus congrue, afin de bénéficier au mieux de la protection du cyclo précédent, comme rempart pour progresser en optimisant l’effort. Dans cette situation, la tension psychique est intense. Maintenir son équilibre dans une zone d’incertitude volontairement réduite à son minimum possible, tandis que l’effort physique est porté à son extrême pour rester dans le peloton, est une situation forcément éphémère. L’effort ne peut durer longtemps pour les moins aguerris. La tension psychique associée à la souffrance musculaire invite rapidement à laisser partir le groupe pour soulager à la fois le cerveau de sa concentration et/ou la douleur musculaire, au détriment d ‘un constat au moins temporaire d‘échec personnel.
- Le peloton : c’est bien sûr la situation la plus classique, car pour avancer le plus efficacement, il faut rester groupés. Mais la zone indispensable pour un freinage sécurisé est escamotée au profit de la confiance que le groupe s’attribue. C’est la coordination de groupe qui permet de rester dans les roues avec une distance de sécurité variable selon chaque individu, mais de toute façon bien inférieure à la distance de freinage. La réaction successive presque instantanée de chacun permet de ralentir ou de s’arrêter ensemble. C’est la réalité le plus souvent, mais la perception du danger et le temps de réaction de chacun ne sont naturellement pas les mêmes. C’est d‘abord la personnalité innée et acquise qui module la réaction de chaque individu.
Il est des cyclos plus intrépides qui ont beaucoup d’expérience et peu de chutes, il en est d’autres plus méfiants qui conserveront une distance de sécurité plus grande.
Les vététistes, les « cyclocross men » seront sur la route plus habiles. Il en est d’autres plus âgés probablement un peu moins réactifs. Les expériences passées de chute laissent des images traumatiques. Paradoxalement, plus la peur est présente, plus le risque de chute augmente. Quand la vigilance de tous les instants se mélange avec de la méfiance envers les autres, l’automatisme naturel de réaction à un imprévu risque d’être excessif et brutal. Tout ce petit monde doit cohabiter, collaborer, s’harmoniser. Est-ce vraiment si facile quand la composante humaine est la seule en jeu et responsable ?
La faillibilité de l’humain : la gestion de la charge mentale
À vélo, nous avons la perception de ne faire qu’un effort physique, même pour être concret, uniquement musculaire, pourrions-nous dire ! C’est cette impression de ressenti du muscle, d‘abord sensible, puis des cuisses douloureuses qui laisse ce souvenir impérissable ! Pourtant, le vélo n’est pas une technique dont l’automatisme est acquis. Guider son vélo nécessite une charge mentale non négligeable. La preuve est flagrante lorsque l’on compare les sensations par rapport à la course à pied. Sur un vélo, il est exceptionnel de ressentir cette euphorie si prisée des coureurs à pied. Le triathlète même qui vient pourtant de nager puis de pédaler lorsqu’il aborde la course à pied, s’il est en bonne forme, peut bénéficier de cette sensation d‘euphorie et de de bien-être. La libération des hormones « endorphines » par les cellules du cerveau en serait la cause. La dopamine n’est-elle pas aussi appelée « hormone du bonheur » ? La dopamine est sécrétée en plus forte concentration au cours des efforts, mais alors pourquoi pas sur un vélo ? Chez le cycliste, la dopamine est sécrétée bien sûr, mais peut-être dans une moindre mesure. Ses effets euphorisants sont manifestement entravés par la concentration nécessaire au maintien de l’équilibre. Celle-ci impose une charge mentale qui sollicite essentiellement le cortex préfrontal. Ce dernier est la zone du cerveau qui a connu le plus grand développement chez l’être humain sur une évolution de plusieurs millions d‘années. Cette tension au niveau de la partie préfrontale du cerveau sera prédominante et va inhiber ou au moins diminuer l’effet de la sécrétion de la dopamine et sa résultante tant appréciée, ce « bien-être éphémère » euphorisant, dont les coureurs à pied bénéficient.
Peut-on faire plusieurs tâches en même temps… sans risque ?
Dans le cas d’une double tâche cognitivo-motrice, comme s‘orienter en maintenant l‘équilibre à vélo, le partage des tâches ainsi créées peut conduire à une baisse de performance, voire à l’extrême à une instabilité de l‘équilibre, voire sa conséquence ultime : la chute ! Le seul fait de regarder son compteur nécessite une concentration mentale associée à une accommodation oculaire plus ou moins aisée, surtout l’âge avançant. Le temps passé à regarder, voire la concentration nécessaire pour manipuler son compteur GPS, amène à une dérive de la trajectoire plus ou moins marquée. Le temps pour retrouver la vision de loin avec la dilatation pupillaire utile constitue une autre période d’incertitude de conduite. On prend conscience alors que ces attitudes pourtant si banales, qui semblent comme naturelles, représentent en réalité, par leur répétition, une charge mentale indiciblement usante dans le temps. Cela peut expliquer par sa banalisation et son automatisme une baisse indicible de la vigilance ou de la performance. C’est encore plus le cas lors d’un effort physique réalisé dans un environnement complexe, comme celui d’un trafic dense ou de rouler en peloton. L’incertitude mentale est encore plus nette lorsque le groupe est constitué d’individus qui ne se connaissent pas, où chacun peut décider de s’engager différemment, avec sa propre trajectoire dont il a apprécié les bénéfices supérieurs aux risques, uniquement pour lui-même, en occultant, bien souvent, les conséquences directes pour la trajectoire de ceux qui le suivent. C’est alors à eux de s‘adapter !
La gestion de la fatigue : normalement sous contrôle ?
La fatigue est une évidence lors de la pratique du vélo de longues distances. N’a-t-on pas appelé les coureurs cyclistes les « forçats de la route » ? Nous connaissons tous cette sensation de ne plus avoir de ressources suffisantes pour maintenir un effort. C’est une bonne chose en réponse à l’effort physique qui appelle à un repos compensateur nécessaire. C’est cette alternance qui contribue à la progression de nos performances. Mais cela peut être parfois l’indice d’une fatigue accumulée qui peut alors avoir des conséquences négatives. Notre capacité d‘attention est alors amoindrie, dans l’instantanéité qu’exige l’équilibre à vélo, de mauvaises décisions peuvent être prises concernant la trajectoire utile. Sommes-nous toujours capables d‘évaluer l’importance de cette fatigue et comment la gérer ? D’abord, qu’est-ce que la fatigue ? À vélo la fatigue physique est naturellement identifiée comme une augmentation de la perception de l’effort et de l’apparition de tension musculaire, pour maintenir une puissance donnée. La fatigue mentale se traduit dans les mêmes circonstances d‘effort physique par une diminution de nos capacités de jugement, un équilibre plus qu’incertain, ainsi qu’une irritabilité accrue ! On prend alors conscience que la fatigue physique n’est pas que musculaire et que la fatigue mentale n’est pas que psychologique. Cela a des conséquences sur la conduite non négligeables.
Mais sommes-nous habitués à nous dépasser…
… Quand le jeu en vaut la chandelle, c’est-à-dire selon nos enjeux personnels. C‘est là que nous devenons vulnérables. Nous devenons plus impulsifs dans nos décisions, privilégiant les bénéfices à court terme. Cette perte partielle du jugement peut avoir de lourdes conséquences. Plus la sortie se prolonge, plus naturellement la fatigue musculaire se ressent. La fatigue mentale s’installe indiciblement, le maintien de l’équilibre et la conduite deviendront un peu plus aléatoires. Nous ne parlons là que de la pratique cycliste sur une sortie. Chaque individu a aussi sa propre vie et ses propres angoisses et ennuis qu’il ressasse et essaie de mettre de côté au cours de l’effort physique. Mais ils sont quand même présents, et mentalement ne sont pas sans conséquence. Un effort trop long ou trop souvent répété aura l’effet inverse de celui recherché. La chronicité de la fatigue physique a pour conséquence une diminution des performances du sportif. Il se trouve alors en échec. Psychologiquement, il sera irritable, l’individualité prendra le pas sur le respect du groupe. Son espace vital d’équilibre s’agrandit pour lui, sans qu’il en prenne réellement conscience, rendant les autres responsables de conduites déviantes. Dans cette position, il a perdu la lucidité pour se remettre en question et accepter que ce sont ses systèmes d‘alerte vis-à-vis de la fatigue qui se sont déréglés. Outre son humeur à la fois irritable et à tendance dépressive, sa capacité à prendre de bonnes décisions sera altérée. Le risque de chute deviendra plus important.
Nous ne savons pas encore expliquer pourquoi une surcharge d’activité physique induit un dysfonctionnement sur le système de contrôle cognitif, mais c‘est une évidence dans la réalité des chutes à vélo.
Pour notre sécurité : Un peu d’humilité et tout un apprentissage
Il faut donc apprendre à mieux se connaître, évaluer ses propres capacités de l’instant. Le risque maximal de chute ne survient pas forcément au moment de l’effort intense où la douleur musculaire domine, faisant prendre conscience au cyclo de sa fragilité et inconsciemment le mettant en alerte sur la diminution de ses capacités cognitives. C’est dans le relâchement indispensable et inéluctable qui suit que le risque augmente. La récupération musculaire va de pair avec un relâchement cognitif imperceptible tant le soulagement musculaire est prédominant. C’est alors que l’écart et/ou la perte d ‘équilibre survient plus facilement pendant cette phase nécessaire de récupération.
Autrement dit, un état second de surveillance de sa propre vigilance doit rester en éveil pendant la période de récupération active sur le vélo !
Bien se connaître, bien évaluer son état physique et mental du moment, c’est la base de la sortie vélo. Surtout en groupe ! Savoir évaluer son état de fatigue musculaire est une évidence, mais apprécier son état cognitif n’est pas habituel bien que cela représente une grande partie de la solution pour conserver son intégrité physique. Prendre conscience qu’en peloton ce n’est pas obligatoirement l’autre qui commet une erreur de trajectoire, mais que l’intolérance au groupe devient un signe évident d’épuisement psychique.
TEMOIGNAGE: un exemple concret de l’effet de la charge mentale
Antoine, responsable d’un groupe de cyclo du club de notre région, propose par la messagerie WhatsApp d‘avancer au matin la sortie prévue le mercredi après-midi à 14 h. L’argumentation est de bénéficier de meilleures conditions météorologiques et sans doute aussi un petit intérêt personnel en arrière-pensée ! Le leader prénommé « sage » dans ce club est chargé de mener le groupe sur un parcours déterminé à l’avance pour chaque sortie de l’année. Il doit donc l’avoir étudié et préenregistré sur son GPS.
Il sera rappelé à l’ordre sur la messagerie par la communauté. On ne peut modifier les rdvs sans exclure certains cyclos, en particulier ceux qui travaillent et se libèrent pour le R.-V. hebdomadaire déterminé. L’horaire de 14 h sera donc maintenu.
Entre-temps, il apprend de façon informelle, grâce à un cyclo passé sur la trace, que la route s’est bien dégradée avec les intempéries hivernales sur une portion proche du 60e km. Au R.-V. de 14 h, il en parlera avec un de ses acolytes aussi responsable. Celui-ci, bien que ne voyant pas exactement où se situe la portion de route mentionnée, est d’accord pour la squeezer. Il fait confiance à son ami pour modifier le parcours en conséquence. La sortie se déroule sans incident, mais le sage oublie au cours de la routine de la sortie son intention de modifier le parcours. Ils arrivent donc sur la portion de route en question. C’est lui qui chutera à l’endroit même qu‘il avait au départ prédéterminé comme potentiellement dangereux. C’est heureusement une chute sans gravité. À postériori, réfléchissant sur les circonstances de sa chute, il réalise que, contrarié de n’avoir pu modifier à sa guise l’horaire de sortie, il menait un groupe dont il s’était, lui-même, mis en retrait ce jour-là !




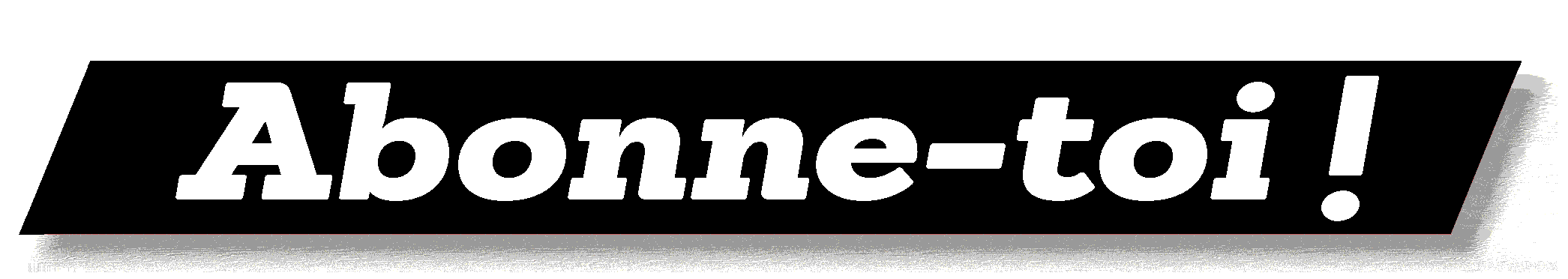
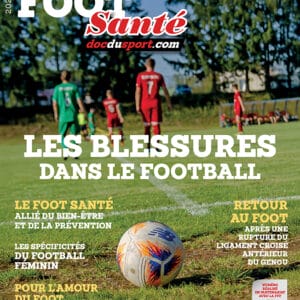

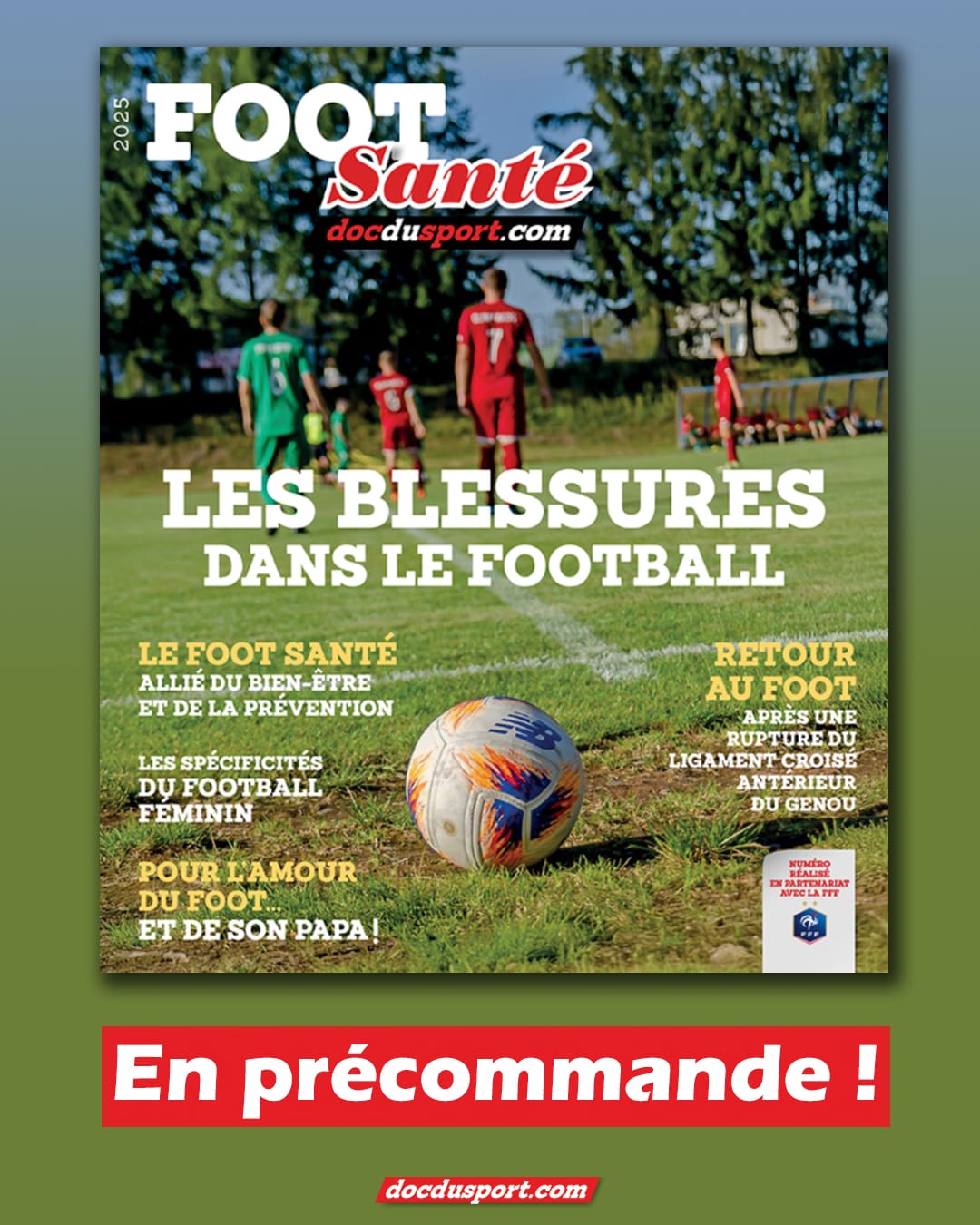

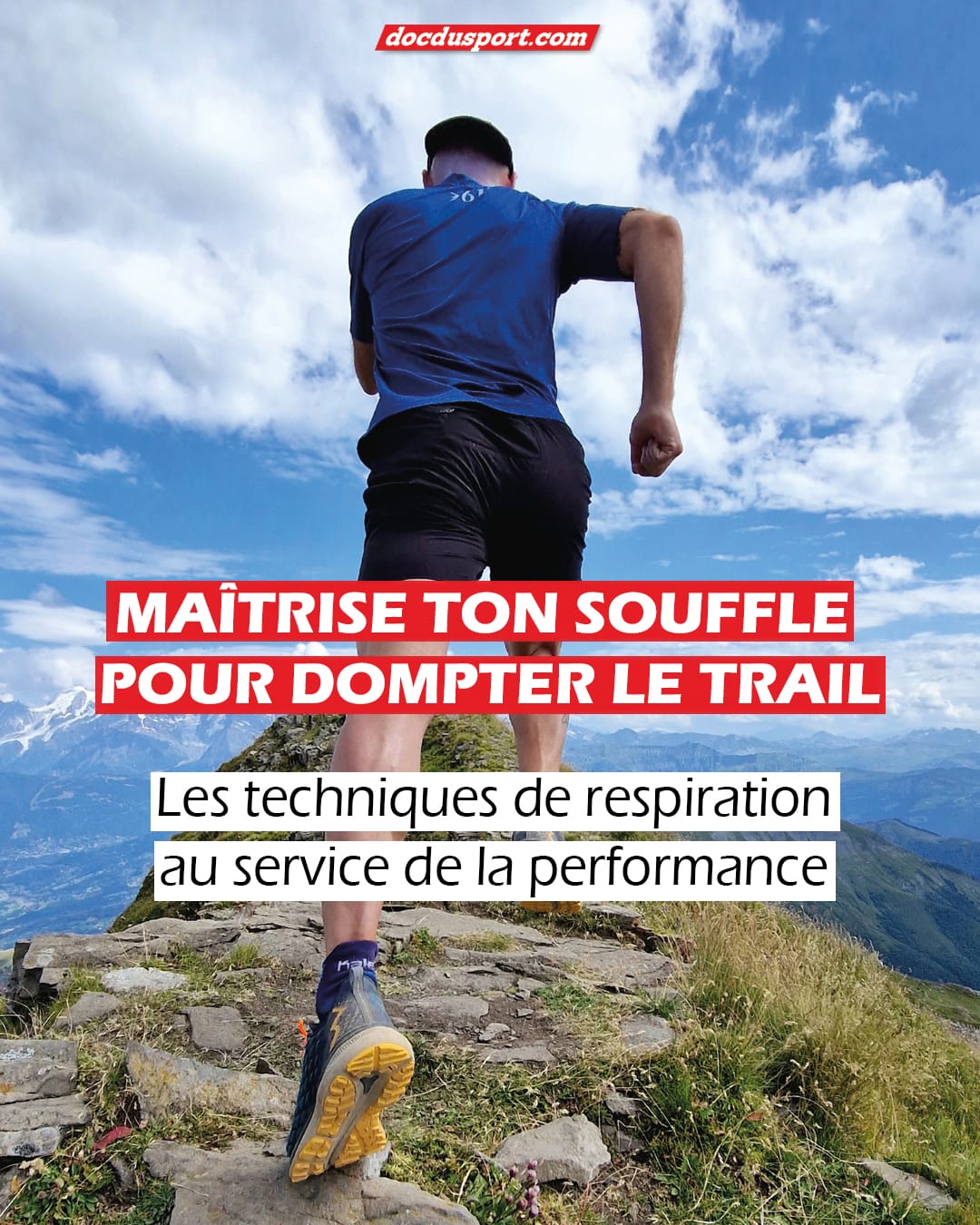
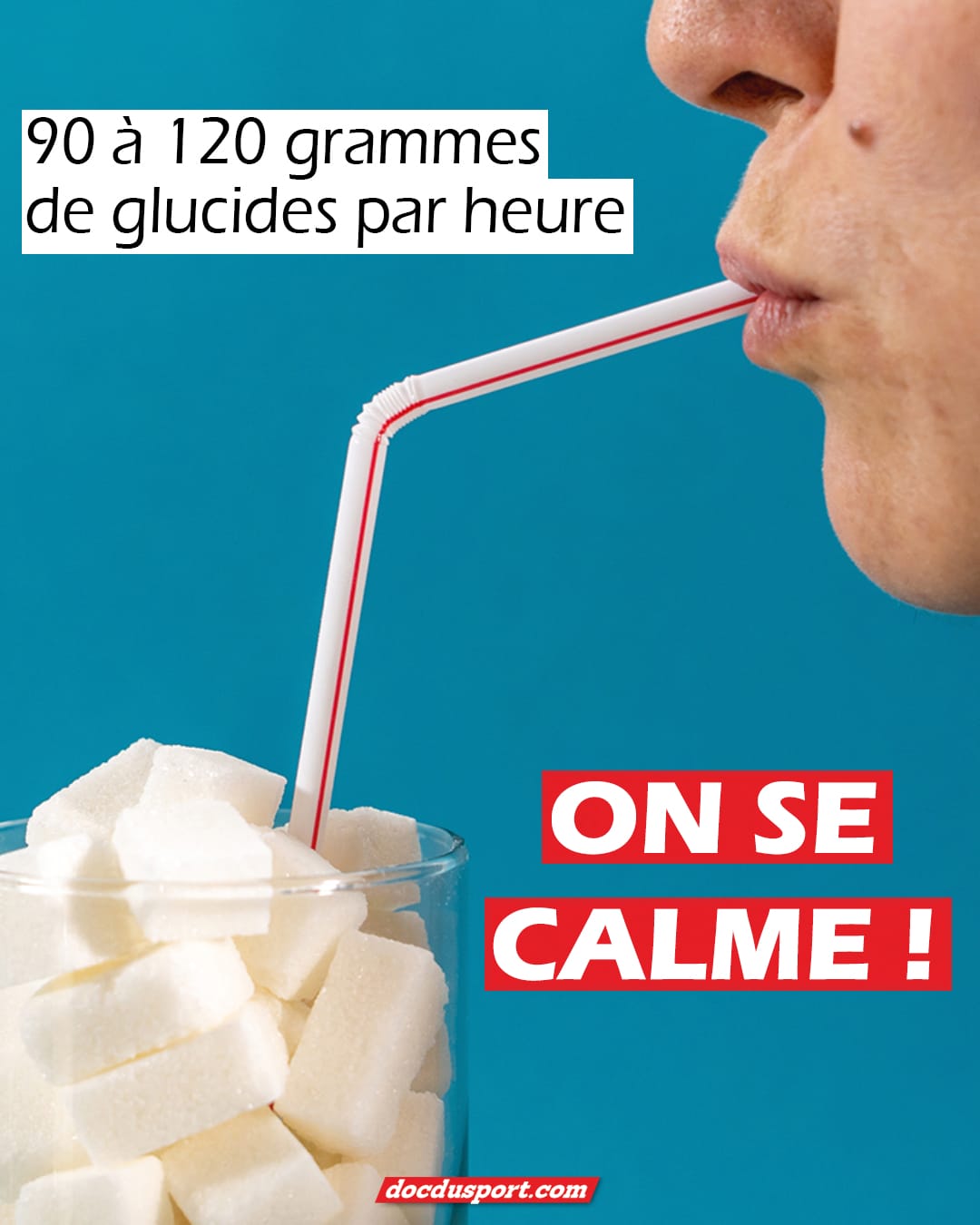

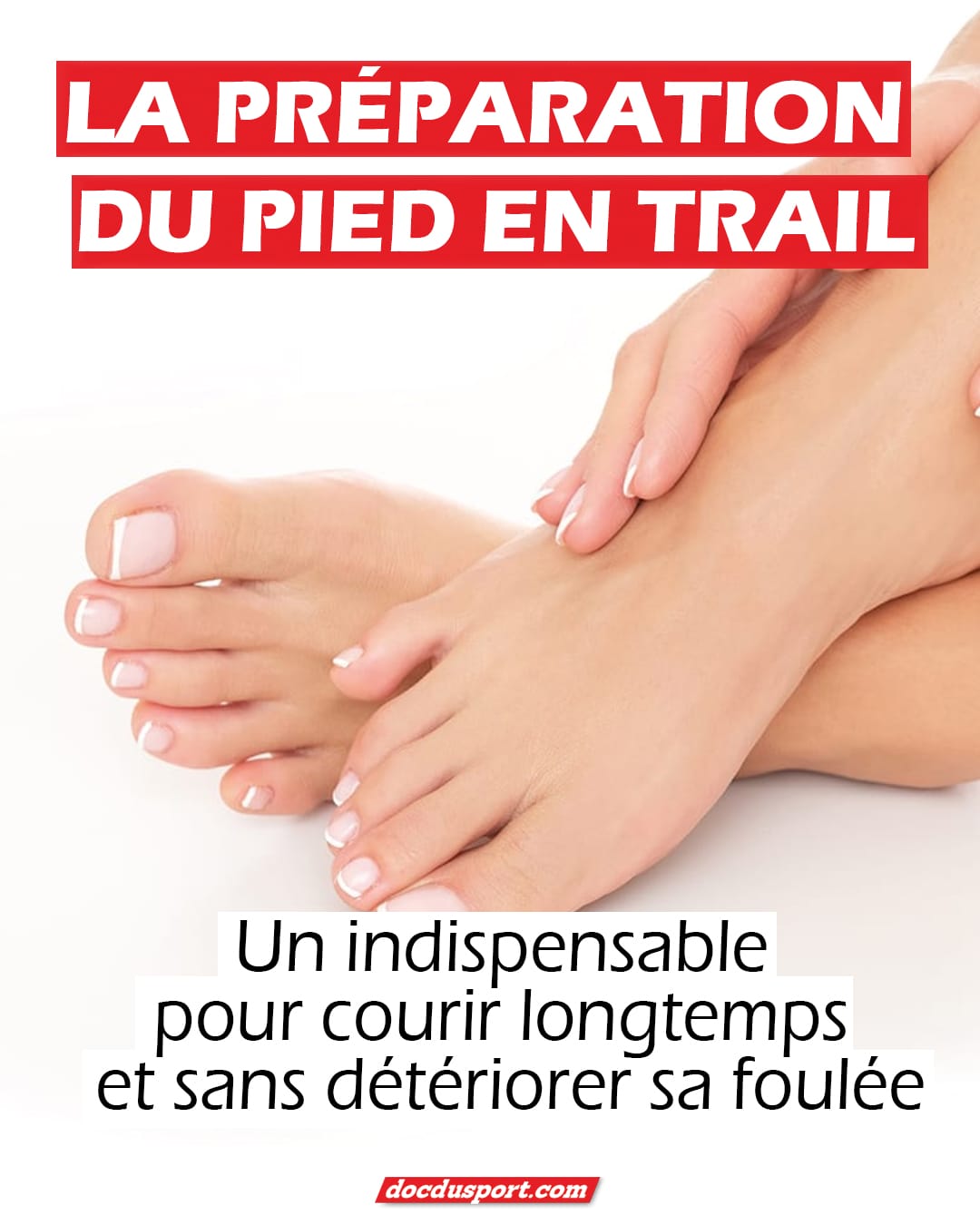
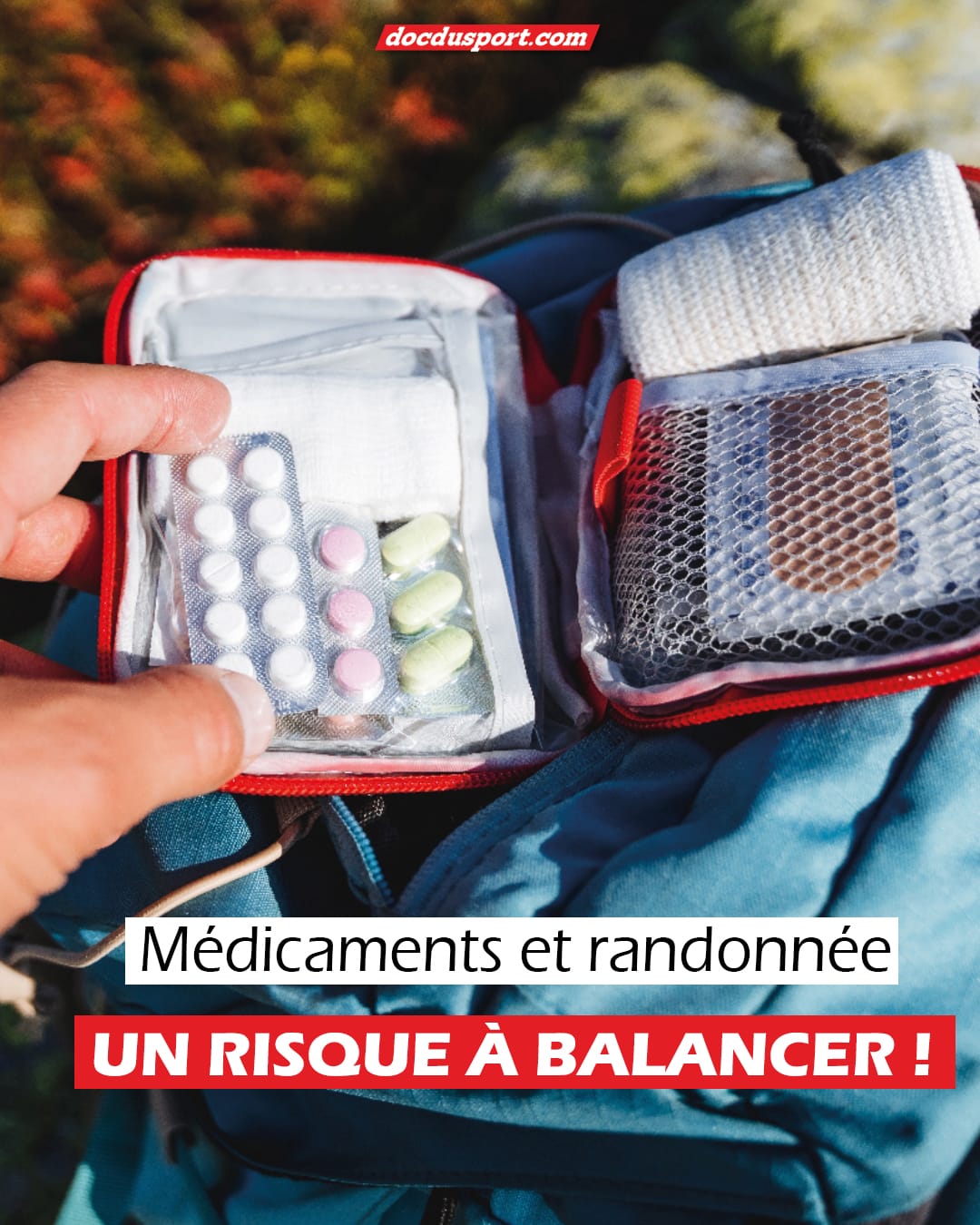



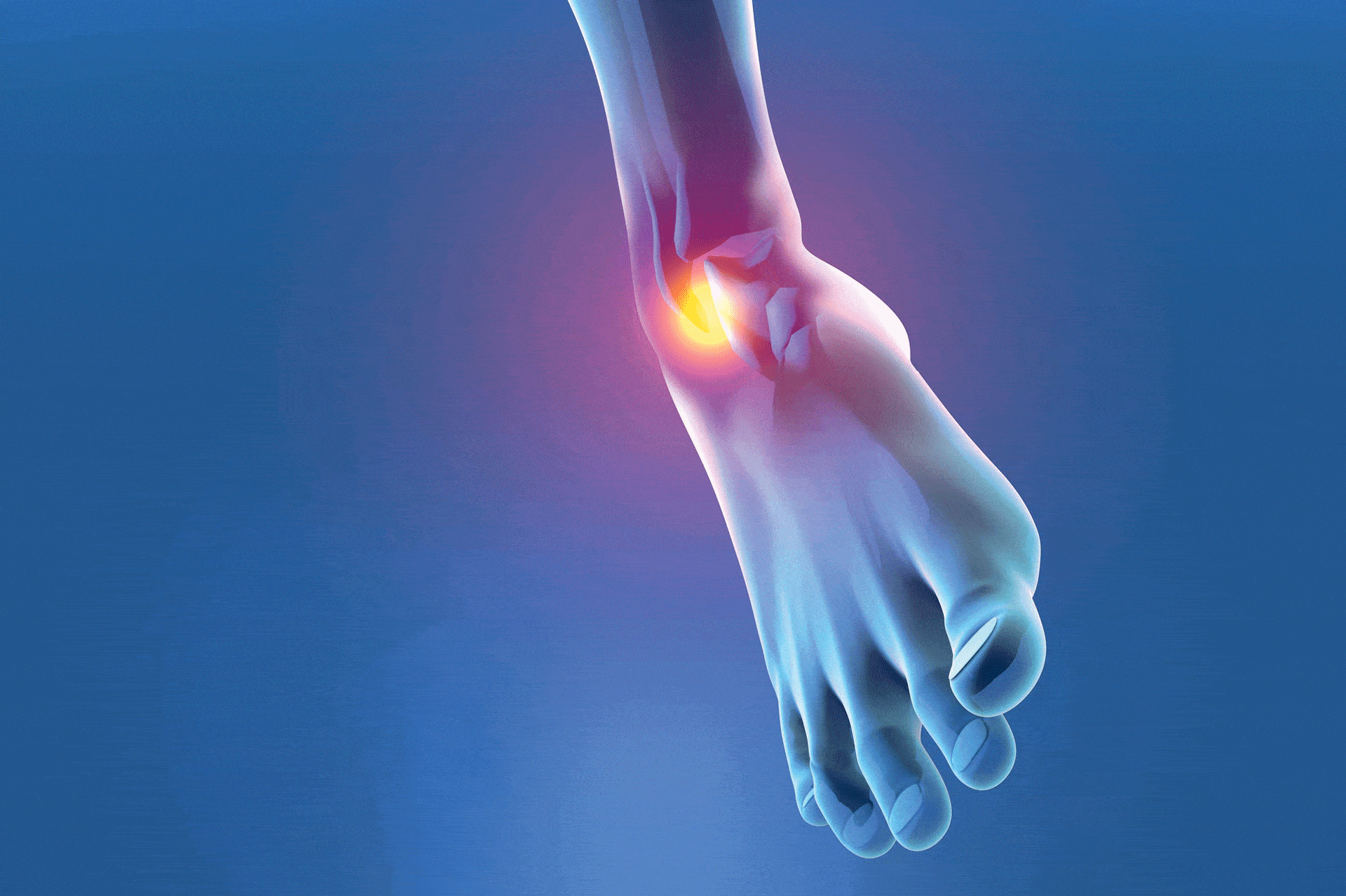















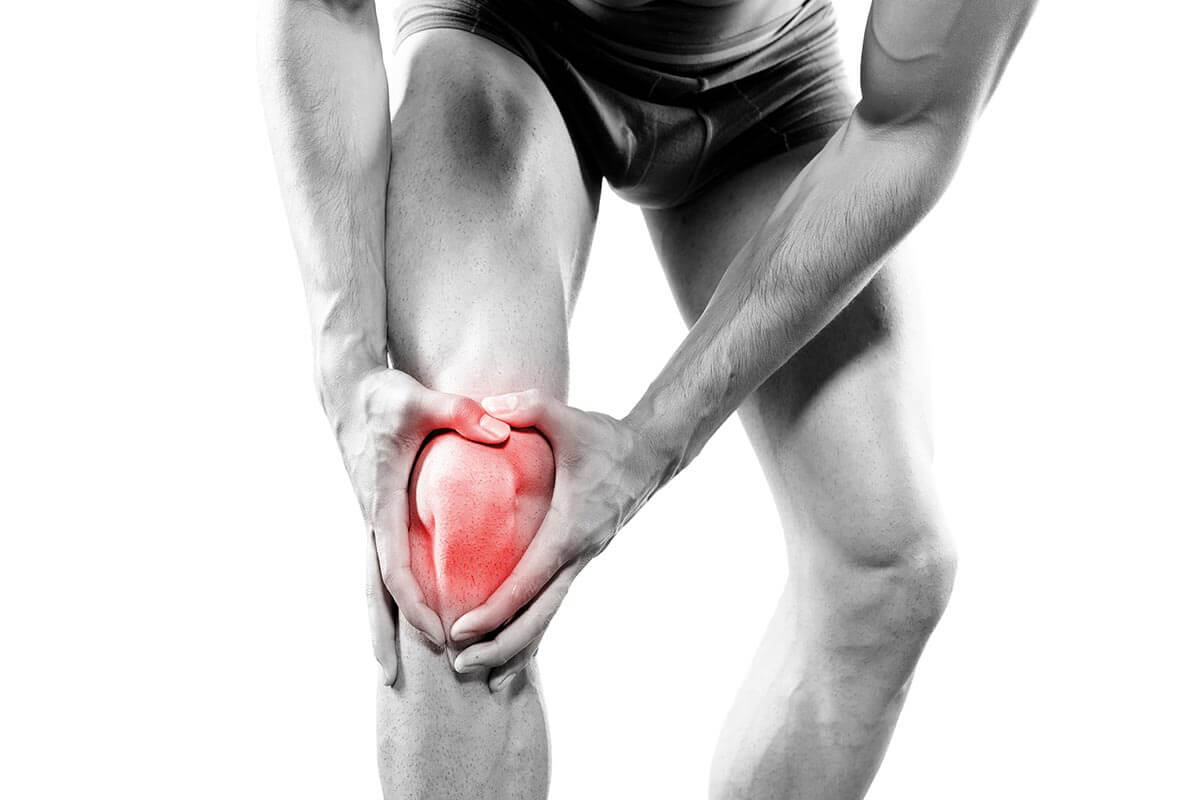




















































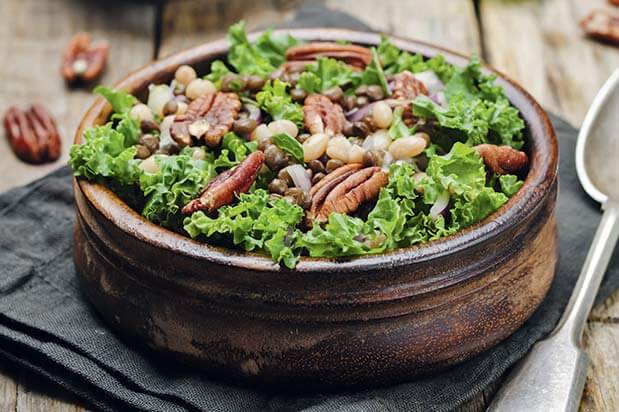














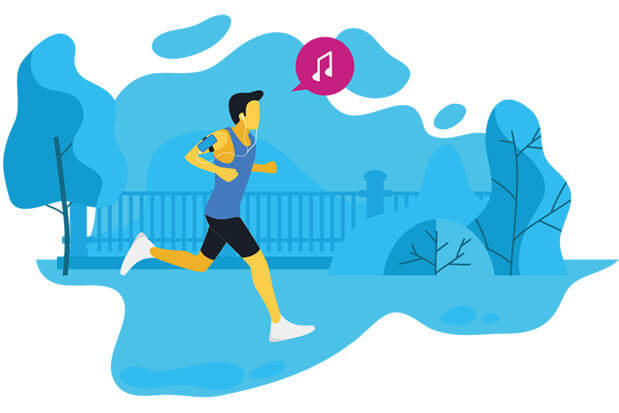









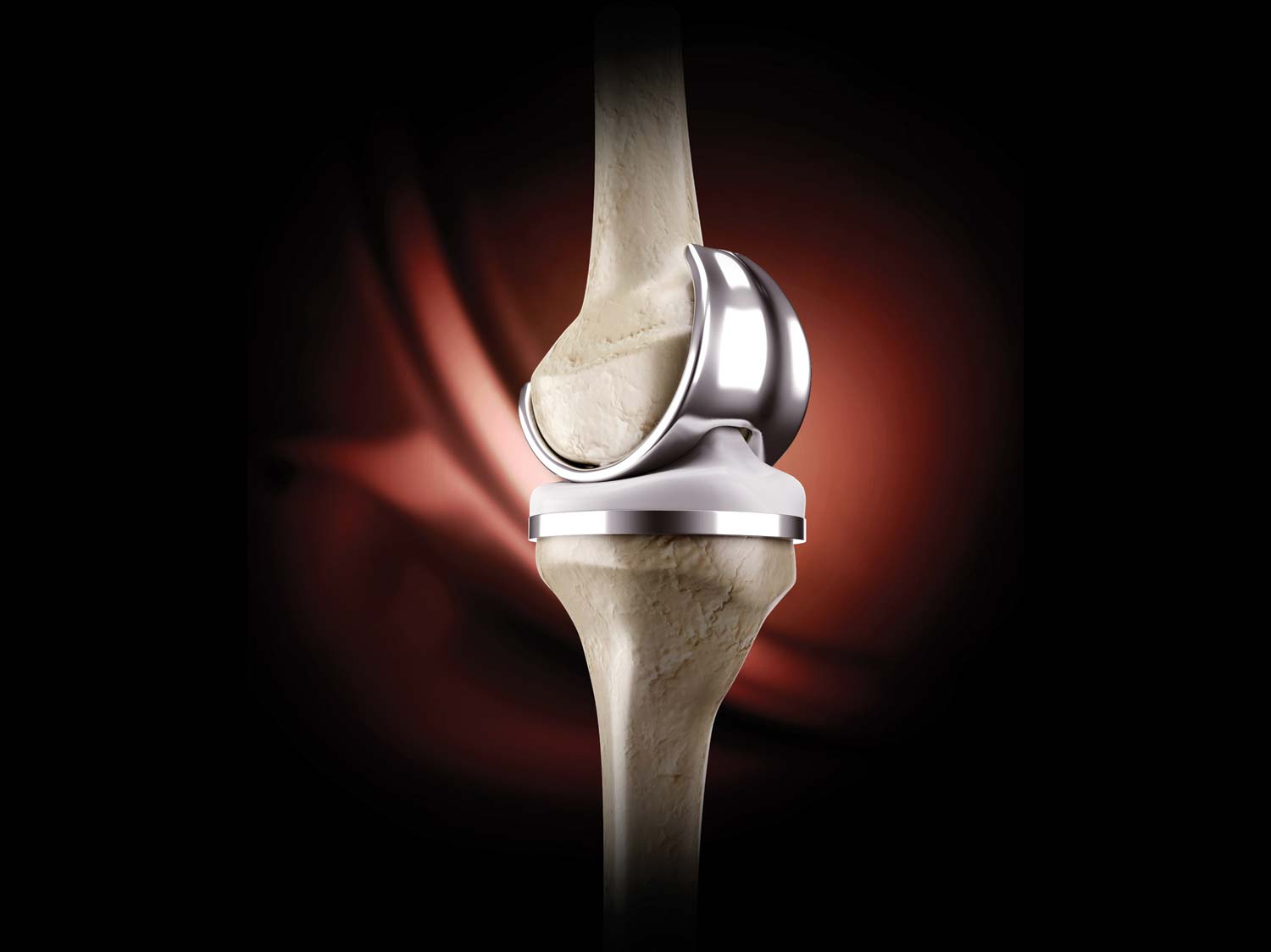
















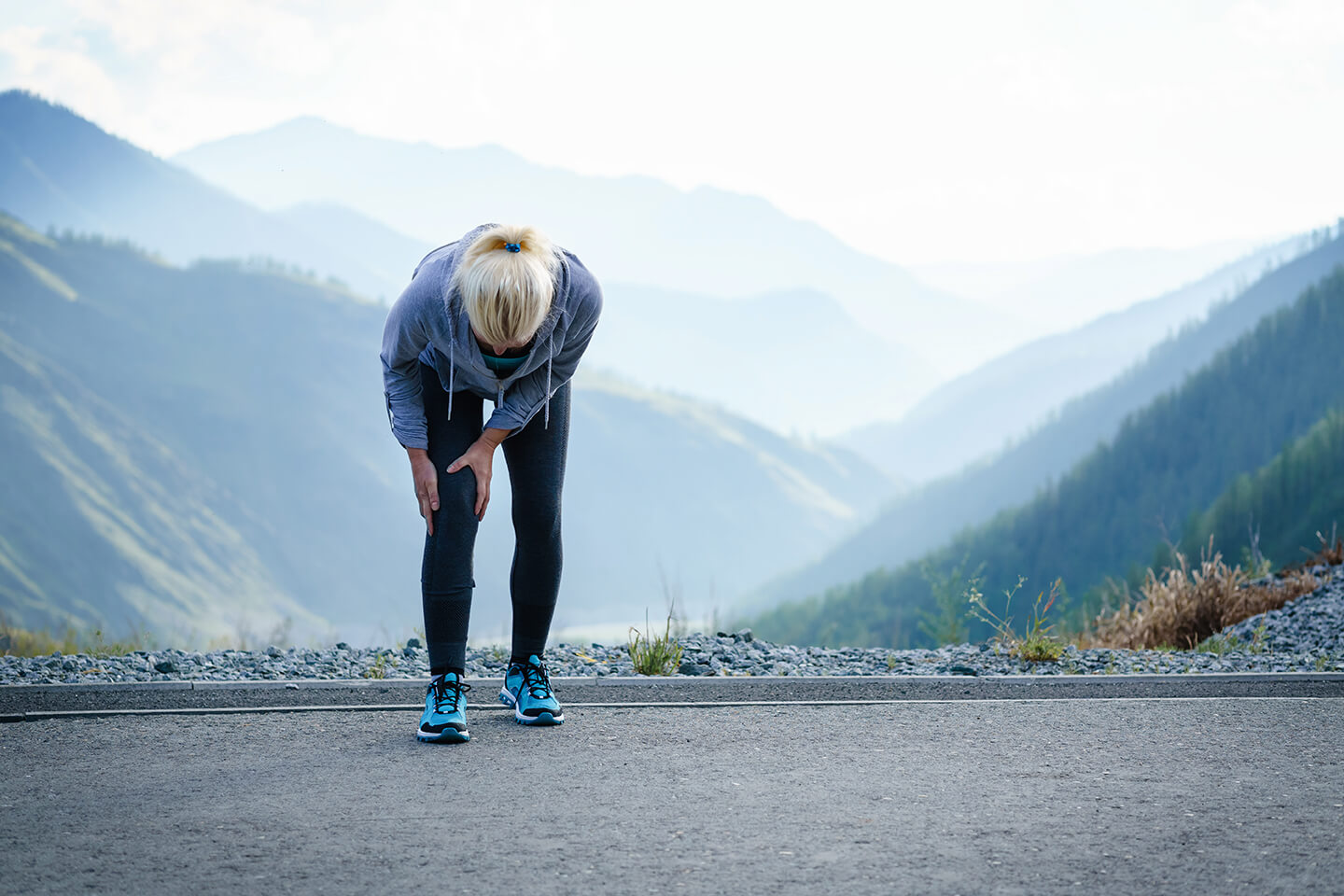



















































































































































































































































































































































































0 comments